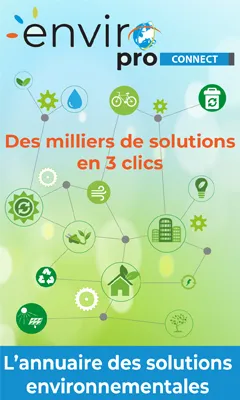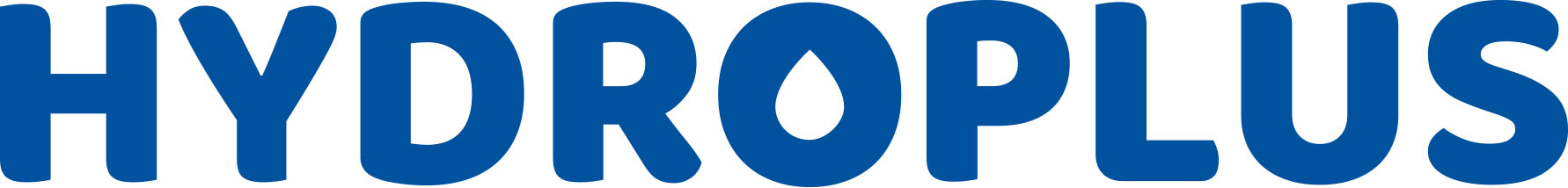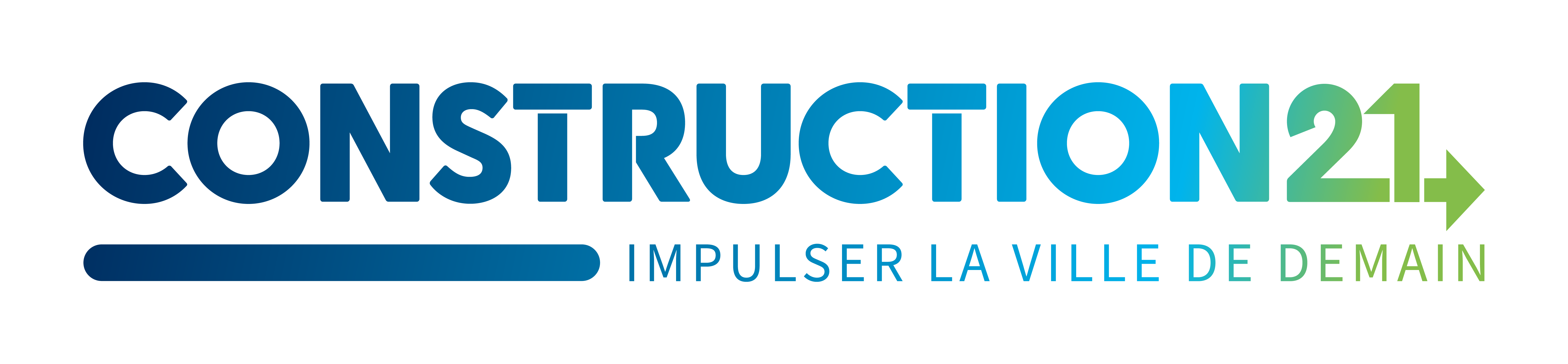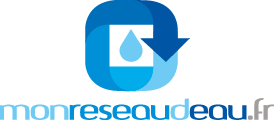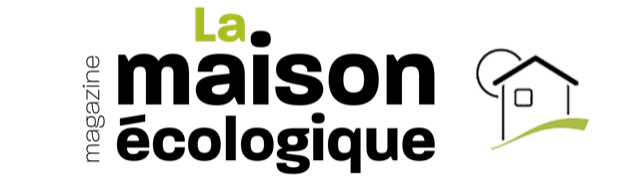Le salon des Solutions
environnementales & énergétique du
Grand Est
Les Actualités
Bilan carbone des jeux olympiques et paralympiques de Paris : des performances en demi-teinte
25/04/2025

Quelque 95 % des infrastructures utilisées pendant les jeux étaient existantes ou bien temporaires. © Audrius - stock.adobe.com
Le Commissariat général au développement durable livre son analyse des émissions de carbone des jeux olympiques de Paris. Si la comparaison avec ceux de Londres ou de Rio lui est favorable, son bilan reste malgré tout moins bon que prévu.
Un pas « important pour la prise en compte de l'impact climatique dans l'organisation des événements sportifs » : tel est le jugement porté par le Commissariat général au développement durable (CGDD) et le cabinet d'audit EY sur le bilan carbone des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 à travers un rapport publié ce mois d'avril (1) . L'été dernier, la compétition aura en effet généré 2,085 millions de tonnes équivalent CO2 (MteqCO2), soit l'équivalent des émissions des Jeux de Tokyo en 2020 qui se sont déroulés sans spectateurs. Ceux de Londres en 2012 ont dégagé 3,3 MteqCO2 et ceux de Rio, en 2016, 3,6 MteqCO2. Le bilan brésilien prend toutefois en compte l'ensemble des infrastructures urbaines prévues ou accélérées pour l'événement, comme de nouvelles lignes de bus ou des ponts, ce qui n'est pas le cas de Paris 2024.
Les transports, dernière roue du carrosse
Les transports représentent près des deux tiers de cette empreinte carbone. Ceux des spectateurs venus d'autres pays sont même la source de près de la moitié du total des émissions de ces JOP de Paris, soit 0,961 MteqCO2. S'y ajoutent les déplacements dans les villes et entre les villes (0,041 MteqCO2). Un progrès est cependant à noter en matière de transports en commun. La desserte de l'ensemble des sites par ce biais et l'accélération des cadences ont largement permis d'améliorer leur usage ainsi que le recours aux mobilités douces.
2,085 MteqCO2 - C'est le bilan carbone des jeux Paris 2024, soit l'équivalent des émissions des Jeux de Tokyo en 2020 qui se sont déroulés sans spectateurs.
Alors que seuls 25 % des Franciliens choisissent généralement de se déplacer en transports publics, près de quatre visiteurs sur cinq ont privilégié ce mode. Près de la moitié d'entre eux ont pratiqué la marche et 7 % le vélo, contre 2 % habituellement. Les émissions liées à l'hébergement des spectateurs sont évaluées à 0,074 MteqCO2. Cependant, l'Île-de-France a accueilli moins de touristes étrangers durant cet été 2024 que pendant l'été 2023, notent les auteurs du rapport. Les émissions de GES provenant de cette activité dans la région ont donc été inférieures d'environ 0,4 MteqCO2 à ce qu'elles auraient pu être sans la compétition.
Faire mieux avec l'existant
Le tiers des émissions restantes, soit 0,7 MteqCO2, provient des activités de préparation, d'organisation et de construction. La rénovation d'infrastructures existantes (Stade de France, Roland Garros, gymnases…) ainsi que l'édification de nouvelles infrastructures (village des athlètes, salle Arena…) ont produit 19 % de l'empreinte carbone, soit 0,389 MteqCO2. C'est 80 % de moins qu'à Londres où ce volet avait représenté près des deux tiers du bilan. En 2020 à Tokyo, il avait pesé pour plus des trois quarts du total.
“ Avec une consommation d'énergie quasiment aussi élevée qu'à Londres, les Jeux de Paris 2024 ont émis près de huit fois moins de GES ” - CGDD
Ce bon résultat est à mettre au crédit du Comité 2024 et de l'État français qui avaient fait le choix d'utiliser à 95 % des infrastructures existantes ou temporaires, mais aussi à celui de la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo) qui avait décidé d'améliorer le bilan des chantiers, en s'appuyant sur un budget carbone prédéfini, régulièrement évalué.
L'utilisation de matériaux bas carbone a ainsi permis de réduire de 30 % l'empreinte des constructions par rapport au standard RT 2012. Des efforts ont également été accomplis sur l'ensemble du cycle de vie des projets, via la gestion de la fin de vie des matériaux, la reconversion des usages, le rattachement au réseau de géothermie, la limitation du recours aux groupes électrogènes, l'amélioration de l'isolation thermique ou des achats plus responsables.
Un bilan moins positif que prévu
La préparation et l'organisation des Jeux ont, quant à elles, totalisé 16 % des émissions à Paris, soit 0,327 MteqCO2. La France a en outre bénéficié de deux atouts « structurels » importants : la possibilité d'accéder aux réseaux ferroviaires européens et un mix énergétique moins carboné. « Avec une consommation d'énergie quasiment aussi élevée qu'à Londres (70 GWh contre 77 GWh en 2012), les Jeux de Paris 2024 ont émis près de huit fois moins de GES », estime le CGDD. Si cet inventaire s'avère meilleur que ceux d'autres compétitions similaires, il est cependant loin des ambitions premières des organisateurs.
En 2021, ils avaient promis de concevoir les premiers jeux à « contribution positive pour le climat » avant de se raviser deux ans plus tard, en tablant plutôt sur 1,58 MteqCO2. C'est encore 0,505 de moins que le résultat final. « Plusieurs objectifs contradictoires semblent se présenter aux organisateurs de grands événements », expliquent les auteurs : minimiser les impacts de l'événement sur l'environnement, mais l'organiser dans un grand nombre de villes-hôtes pour contribuer à un aménagement équilibré du territoire et bénéficier des infrastructures existantes, assurer l'équilibre budgétaire en maximisant le taux de remplissage et en privilégiant les destinations dotées de la plus grosse capacité touristique, maximiser les dépenses des touristes internationaux sur le territoire en accueillant des publics à fort pouvoir d'achat…
Un début de solution pourrait consister à cibler plus particulièrement les spectateurs européens, grâce à une stratégie de billetterie adaptée. En accueillant seulement 5 % de spectateurs extraeuropéens, les émissions totales des Jeux auraient pu diminuer de 13 % (- 270 kteqCO2), calcule le CGDD. À l'inverse, si les Jeux avaient accueilli 13 % de spectateurs extraeuropéens (soit 4 % de plus), leur bilan aurait augmenté de 19 %. Il reste à espérer que les jeux olympiques d'hiver dans les Alpes, en 2030, tireront parti des enseignements de cette étude.
Nadia Gorbatko / actu-environnement