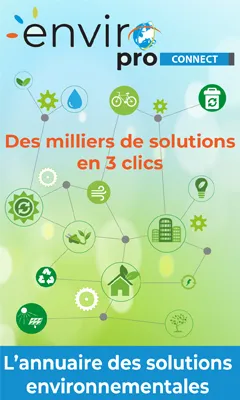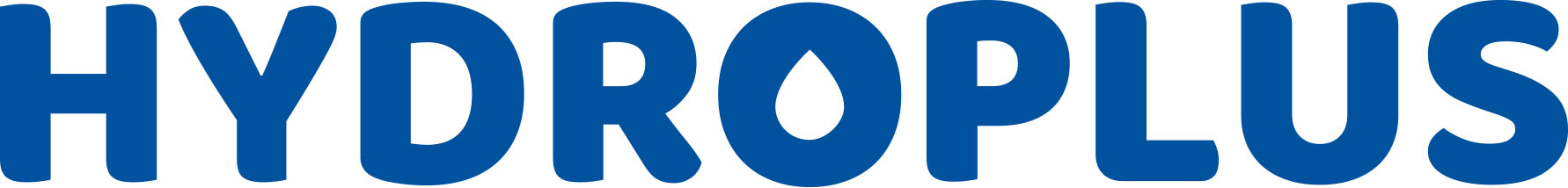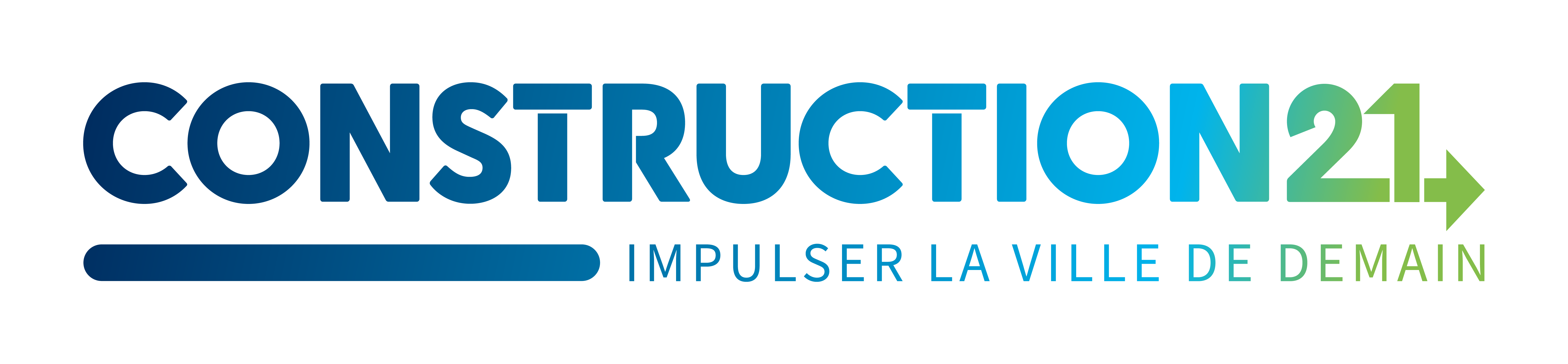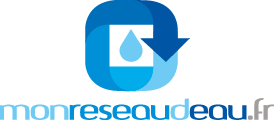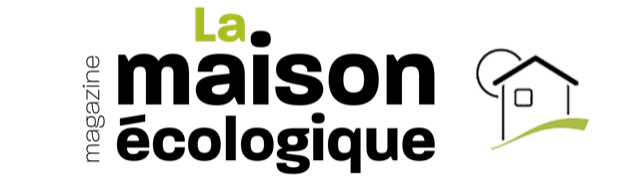Le salon des Solutions
environnementales & énergétique du
Grand Est
Les Actualités
Visualisez l'ampleur de la fonte des glaciers et ses conséquences en France et dans le monde
13/04/2025

Le glacier Blanc, photographié le 12 juillet 2021 dans le massif des Ecrins (Hautes-Alpes), subit depuis des années un important recul à cause du changement climatique. (LEO PIERRE / AFP)
Les Nations unies ont fait de 2025 l'année internationale de la préservation des glaciers. Ce vendredi est la première journée mondiale consacrée à ces écosystèmes menacés par le réchauffement climatique.
Il y a un siècle, la langue de glace descendait jusque dans la vallée entre les deux montagnes. Aujourd'hui, elle a en partie disparu, laissant place à un canyon sec. La Mer de Glace, près de Chamonix, dans les Alpes, a perdu plus de la moitié de sa surface en un siècle. Le célèbre glacier est loin d'être le seul à fondre : "Le caractère planétaire du recul des glaciers depuis les années 1950 (...) est sans précédent depuis au moins 2000 ans." Le phénomène "touche simultanément la quasi-totalité des glaciers du monde". Et l'homme est "le principal facteur" de ce recul.
Tel est le glaçant constat établi dans le dernier rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec). Pour susciter une prise de conscience dans l'opinion publique, les Nations unies ont donc décrété 2025 année internationale de la préservation des glaciers, faisant du vendredi 21 mars la première journée mondiale annuelle consacrée à ces écosystèmes menacés par le réchauffement climatique. A cette occasion, franceinfo vous propose de visualiser la fonte des glaciers et ses conséquences en cinq infographies.
La fonte s'accélère depuis les années 1990
Sous l'effet de la hausse des températures, auquel ils sont très sensibles, les glaciers fondent. "Depuis le milieu du XIXe siècle, [ils] ont connu une perte de masse de glace importante", note l'observatoire européen Copernicus sur sa page consacrée à leur suivi(Nouvelle fenêtre). Selon les données du World Glacier Monitoring Service (WGMS), ils ont perdu 8 226 gigatonnes depuis 1976. Et leur fonte s'est accélérée depuis les années 1990, comme le montre le graphique ci-dessous.
Un phénomène qui n'est pas près de s'arrêter. "Les glaciers vont inexorablement continuer à fondre pendant des décennies ou des siècles", prévient le dernier rapport du Giec. Jusqu'à quel point ? Tout dépendra de la capacité des hommes à réduire dans les prochaines décennies leurs émissions de gaz à effet de serre. "Si le réchauffement planétaire est situé entre 1,5°C et 4°C, les glaciers de montagne perdront entre 26% et 41% de leur masse totale par rapport à 2015 d'ici à 2100", évaluent les Nations unies dans leur rapport sur les ressources en eau.
Toutes les régions du monde sont concernées
Il existe plus de 275 000 glaciers dans le monde, selon l'Organisation météorologique mondiale (OMM). Sur le terrain ou depuis l'espace grâce aux satellites, 96% d'entre eux(Nouvelle fenêtre) sont observés et leur fonte est mesurée et documentée. Des mesures qui permettent de constater que ces écosystèmes sont menacés dans toutes les régions de la planète. Le Giec met toutefois en avant des taux de fonte particulièrement élevés "dans le sud des Andes, en Nouvelle-Zélande, en Alaska, en Europe centrale et en Islande".
"L'Europe et tout le nord de l'Arctique se réchauffent énormément. On a tendance à perdre plus dans les Alpes que dans d'autres régions du monde", décrit Delphine Six, directrice adjointe de l'Institut des géosciences de l'environnement (IGE) à Grenoble. Un constat visible sur la carte ci-dessous, qui prend pour unité de mesure le mètre équivalent eau (m w.e.), c'est-à-dire l'épaisseur perdue par les glaciers transposée en eau liquide. "-1,3 mètre équivalent eau, c'est comme si on rabotait la surface de tout le glacier d'1,5 mètre de glace en moyenne", illustre Delphine Six. En rouge, figurent les glaciers qui ont perdu de la masse sur un an ; en bleu le peu qui en a gagné.
La situation s'est encore aggravée en 2023, comme le montre la carte réalisée par Copernicus à partir des mêmes données. "On ne voit aucun point bleu, aucune des régions n'a montré un bilan positif en 2023", s'inquiète Isabelle Gärtner, responsable scientifique du WGMS. L'année a d'ailleurs enregistré la plus grande perte de glace jamais observée depuis 1950. Cette année-là, "la perte de masse des glaciers correspond à cinq fois la quantité d'eau contenue dans la mer Morte", compare l'Organisation météorologique mondiale dans son rapport annuel(Nouvelle fenêtre).
Un constat similaire s'esquisse pour l'année 2024. "Les observations rapportées jusqu'à présent pour 2024 indiquent des pertes records dans certaines régions, la Suède affichant les niveaux de fonte les plus élevés en 80 ans d'observation", souligne un rapport des Nations unies(Nouvelle fenêtre). "Actuellement, 2024 est également sur une trajectoire de perte record en Asie. Des chutes de neige extrêmement faibles combinées à des températures estivales extrêmement élevées semblent avoir contribué à la perte élevée de 2024 dans ces régions", complète le document.
Des glaciers ont déjà disparu en France
En France, sept glaciers sont scrutés : dans les Alpes et dans les Pyrénées. Leur état, représentatif de celui des autres géants de glace de ces massifs, est inquiétant. Ils ont en effet "perdu 31 mètres équivalent eau depuis 2001", selon le ministère de la Transition écologique(Nouvelle fenêtre). Jusqu'à disparaître, pour le glacier de Sarenne, situé sur le domaine skiable de l'Alpe d'Huez.
Leur fonte s'explique principalement par "des hivers moins enneigés et plus d'étés chauds", explique Delphine Six. Moins de neige pour s'étoffer et plus de chaleur qui les font ruisseler, donc, mais pas seulement. Les scientifiques observent aussi davantage de dépôts de poussières sur les glaciers, ce qui amène ces masses, d'ordinaire blanches, à absorber plus de rayonnement solaire et à fondre encore plus vite.
"Les glaciers commencent à fondre de mai jusqu'en octobre, alors qu'il y a 30 ans, c'était en juillet et août seulement."
Delphine Six, directrice adjointe de l'Institut des géosciences de l'environnement à franceinfo
La fonte est responsable de la montée des eaux
Dans les zones montagneuses ou polaires, les glaciers stockent de l'eau sous forme de glace. Mais lorsqu'ils fondent, cette eau retrouve sa forme liquide et se déverse dans les cours d'eau, jusqu'à la mer, participant à l'élévation de son niveau. Entre 1971 et 2018, 22% de la montée des eaux dans le monde a ainsi été causée par la fonte des glaciers, selon le rapport du Giec. Soit environ 20,9 mm à l'échelle mondiale.
"Si nous perdions tous les glaciers, la hausse du niveau de la mer qui en découlerait serait de 32 centimètres", a averti Isabelle Gärtner lors du lancement de l'année des glaciers en janvier.
Les glaciers stockeront moins d'eau douce à l'avenir
Les glaciers sont "les meilleurs châteaux d'eau douce de la planète", expliquait la glaciologue Heïdi Sevestre à franceinfo. Lors des mois chauds, les glaciers fondent et alimentent les cours d'eau et les activités qui s'y rattachent, comme la production d'électricité, l'industrie ou l'irrigation des cultures. Ces eaux de fonte s'écoulent en particulier lors des mois d'été, quand la chaleur et la sécheresse rendent l'eau d'autant plus indispensable. La disparition des glaciers met en péril cet équilibre. Or dans le monde, 1,2 milliard de personnes vivent dans des régions montagneuses, dont 115,8 millions en Europe, selon le rapport des Nations unies.
"Faire face à la crise mondiale de l’eau implique de commencer par le haut."
L'ONU dans son rapport mondial sur l'eau
L'ONU alerte dans ce document sur le fait que "60% des ressources en eau douce de la planète proviennent des montagnes", même si, précise-t-elle, c'est souvent la fonte des neiges, et non des glaciers, qui "constitue la principale source de ruissellements". Mais ce double apport d'eau se fait de plus en plus rare, du fait du réchauffement climatique. Les cours d'eau des Alpes devraient ainsi voir leur débit annuel se réduire de 35% d'ici à 2100 par rapport à 2006, selon le rapport onusien.
La courbe ci-dessous, issue d'un article scientifique publié dans Nature(Nouvelle fenêtre), illustre le débit d'eau en été de l'Arve, qui prend sa source dans le Mont-Blanc. Les glaciers ont d'abord fourni de plus en plus d'eau à cette rivière, en fondant plus vite. Jusqu'à un pic d'écoulement. Puis, ils se sont mis à libérer de moins en moins d'eau. "Nos simulations montrent que le débit annuel maximal des glaciers a été atteint récemment ou devrait l'être dans les cinq à dix prochaines années", peut-on lire dans Nature, qui précise que ces résultats correspondent aux tendances générales.