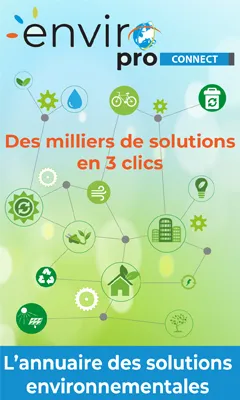Le salon des Solutions
environnementales & énergétique du
Nord
Les Actualités
Bornes de recharge électrique financées par les collectivités : stop ou encore ?
13/06/2024

Pictures news - stock.adobe.com
Pour convaincre les Français de passer à la voiture électrique, les collectivités ont investi à perte dans le maillage du territoire en points de recharge. A présent que les acteurs privés se sont emparés du sujet, elles s’interrogent sur la suite.
Fin 2023, la France a franchi le cap symbolique du million de véhicules électriques en circulation. Depuis, le rythme d’immatriculations ne cesse d’accélérer. Cette fois, l’épopée électrique est bel et bien lancée. Ces dix dernières années, les collectivités y ont largement participé en couvrant le territoire de dizaines de milliers de points de recharge ouverts au public.
« Au début, il n’y avait même pas d’usagers, mais il fallait rassurer les automobilistes qui s’inquiétaient du manque d’autonomie de ces véhicules », se souvient Jean-Jacques Cadet, directeur général des services (DGS) de Territoire d’énergie Drôme (1). « Les gens attendaient nos bornes pour oser y aller, même si, aujourd’hui, on sait que 90 % des recharges ont lieu au domicile », renchérit Jean-Louis Camus, président du syndicat départemental d’énergies de l’Indre (2).
Encouragés par les appuis financiers de l’Ademe, de l’Europe ou des certificats d’économies d’énergie (programme Advenir), les syndicats d’énergie se sont lancés, parfois en tâtonnant, dans l’aventure. « Il y a eu toutes sortes d’initiatives car personne ne savait vraiment où mettre les bornes, quel type choisir, ni comment tarifer tout ceci, se remémore Jean-Marc Proust, président du cabinet GP Conseil. Dans certains départements, il suffisait qu’un riverain demande la borne pour l’avoir. D’autres ont offert le service afin d’encourager le passage à l’acte. » La plupart ont démarré le service en régie publique avant, souvent, de confier l’exploitation à des prestataires, devant la complexité à gérer des infrastructures communicantes.
Les acteurs privés arrivent
Désormais, tout a changé. Environ 1,7 million de points de charge privés sont déployés à domicile ou dans les entreprises, et plus de 127 000 sont ouverts au public (voir les infographies). Sur ce dernier segment, les collectivités qui ont d’abord porté seules le déploiement assistent maintenant à l’arrivée de nombreux acteurs privés. « Ils installent des bornes, soit par contrainte réglementaire – l’obligation d’équiper les parkings, par exemple –, soit parce qu’ils y voient une activité économique à développer », indique Jean-Marc Proust. L’occasion pour les acteurs publics de faire le point sur leurs initiatives.
En Côte-d’Or, où le syndicat mixte d’énergie Siceco (3) a achevé, en 2020, l’implantation d’une quarantaine de bornes, son DGS, Jean-Michel Jeannin, s’en tient à la loi : « Le code général des collectivités précise que les collectivités interviennent à condition de constater une carence du privé. »
Aujourd’hui, si le syndicat envisage la pose de quelques bornes supplémentaires, c’est uniquement dans le but de dynamiser la fréquentation touristique de certains endroits. Pour le reste, « le privé saura aller là où il y a de la demande », assure le DGS. Le syndicat est en train de passer en revue toutes les options concernant son parc actuel, déficitaire de près de 100 000 euros par an. « On réfléchit pour savoir si on continue d’exploiter ou si on le cède au privé », dévoile-t-il.
Le tarif unique, inégalitaire
Dans l’Indre, où les 80 bornes du Sdei dispensent des électrons au tarif unique de dix euros par recharge, quel que soit le temps ou la puissance, « on sait que le système ne peut pas perdurer ainsi, explique Jean-Louis Camus. Le service est très déficitaire, mais aussi inégalitaire, car les petites Zoe paient le même prix que les gros SUV. Certaines de nos bornes sont sous-utilisées. A l’inverse, les acteurs privés s’installent là où il y a de la rentabilité. » A moyen terme, le syndicat envisage de déplacer certaines bornes vers des zones plus attractives, « mais toujours dans une logique d’aménagement du territoire. On ne peut pas abandonner le monde rural, et on sait que le privé n’ira pas ».
Dans la Drôme, Jean-Jacques Cadet n’a pas l’intention de céder la place au privé. En 2020, onze syndicats, dont le sien, ont attribué une délégation de service public à Easy Charge pour gérer leurs 1 200 bornes (réseau Eborn). « Certaines sont très rentables, d’autres pas, c’est tout l’intérêt de les regrouper », appuie-t-il. La subvention d’équilibre d’environ un million d’euros s’amenuise avec le temps, et Eborn espère atteindre bientôt la stabilité.
FOCUS
« Les usagers sont associés à certaines décisions » Catherine Moncet, DGS du syndicat Territoire d’énergie Tarn (ex-Sdet, 387 700 hab.)
« Les élus locaux de notre département du Tarn ont décidé d’associer les usagers du Plein tarnais à certaines décisions concernant la gestion du réseau public de 362 points de charge. Trois arènes de gouvernance ont été organisées depuis 2022, au cours desquelles une trentaine d’usagers, des élus et l’exploitant du réseau ont échangé sur un sujet donné. Ils ont acté ensemble, en 2022, un changement de tarification. Faire payer à la minute était devenu inéquitable car certains modèles chargent plus vite que d’autres. La tarification au kilowattheure a été préférée. Plus récemment, le niveau de tarification a été discuté. Certains usagers voulaient une baisse, mais nous avons expliqué notre volonté d’arriver à un équilibre financier en 2027. Finalement, nous allons examiner la possibilité de proposer une offre plus avantageuse aux riverains. »
Le Sdirve, kezako ?
Afin d’harmoniser le déploiement des infrastructures de recharge pour véhicule électrique (Irve) ouvertes au public, l’article 68 de la loi d’orientation des mobilités prévoit la possibilité, pour les collectivités, de réaliser un schéma directeur de développement, le Sdirve. L’objectif est d’aboutir à une offre coordonnée entre les maîtres d’ouvrage publics et privés. Actuellement, les acteurs privés n’ont pas toujours le réflexe de prévenir les pouvoirs publics lorsqu’ils installent une ou plusieurs bornes sur leur espace foncier. Une fois le Sdirve validé par la préfecture, les nouvelles implantations bénéficient d’une réfaction de 75 % sur les coûts de ...