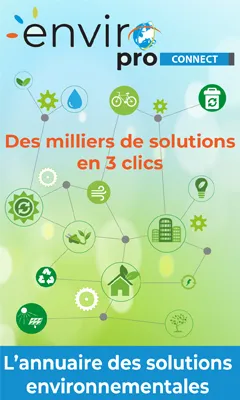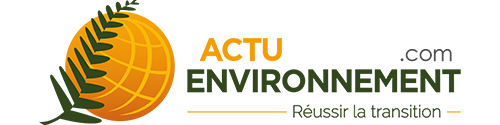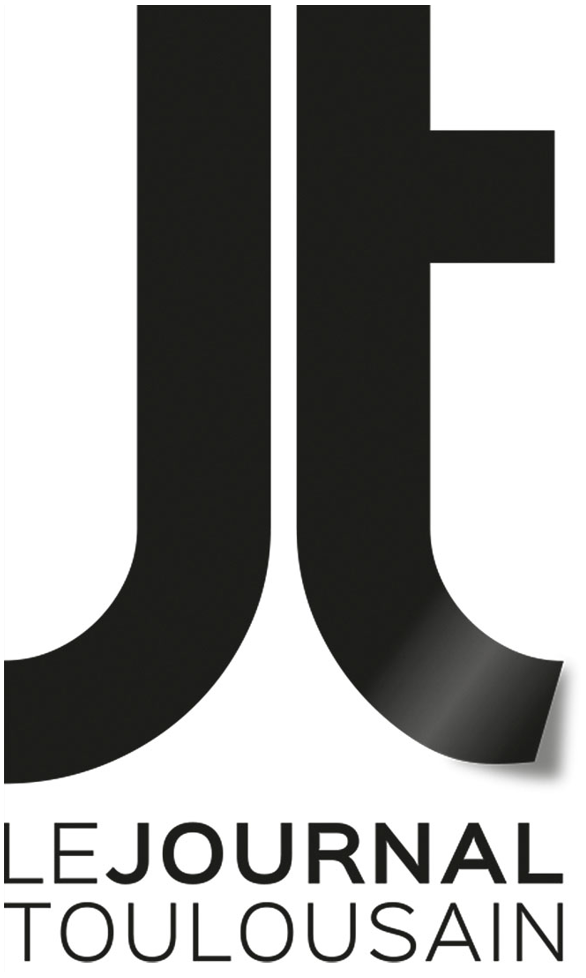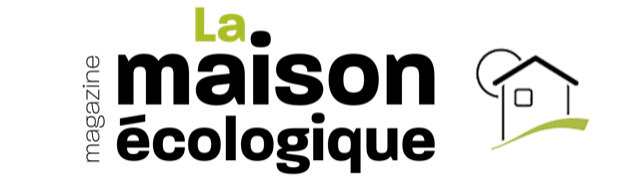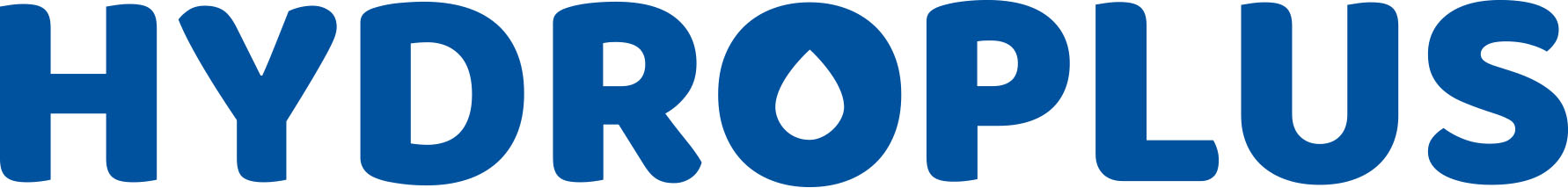Le salon des Solutions
environnementales & énergétique du
Sud-Ouest
Les Actualités
Planification écologique : tout comprendre aux COP régionales
14/04/2025

Lancées en septembre 2023, les COP régionales ont rendu en fin d'année 2024 leurs feuilles de route. Crédits : iStock
Près de deux ans après son lancement en grande pompe par Élisabeth Borne en 2023, la quasi-totalité des régions ont rendu leur plan d'action dans le cadre des COP régionales. Novethic fait le point sur cette initiative que le gouvernement souhaite renouveler.
Vers une saison 2 des COP régionales. Alors que les dernières copies viennent d'être rendues, le gouvernement a annoncé lors du dernier conseil de planification, lundi 31 mars, le renouvellement de cette initiative qui vise à territorialiser la planification écologique. En plus de la conduite d'un "travail plus fin" à l'échelon local, ces COP devront désormais inclure dans leurs travaux le sujet de l'adaptation au changement climatique. En attendant, voici ce qu'il faut savoir sur ces COP régionales en quatre points.
Comment sont nées les COP régionales ?
Beaucoup plus discrètes que les COP sur le climat qui ont lieu chaque année au mois de novembre, ces COP régionales empruntent pourtant le même chemin : celui de lutter contre le changement climatique. Mais l'échelle est quant à elle bien différente. Au lieu de s'adresser aux 196 États, signataires de la Convention-cadre des Nations unies sur le changement climatiques (CCNUCC), cette initiative est à destination des régions de France métropolitaine et d'Outre-mer.
Lancée en septembre 2023 par la Première ministre de l'époque, Élisabeth Borne, ces COP régionales sont la déclinaison territoriale de la planification écologique. Leur objectif : engager des discussions stratégiques avec les principaux acteurs régionaux pour identifier les leviers qui permettront d'atteindre l'objectif de -50% d'émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Car même si une partie de l'action est aujourd'hui fortement déterminée par le niveau national et les décisions gouvernementales, il est également clair que les régions y jouent un rôle crucial.
Qui sont les participants ?
Les régions ont répondu présentes. Fin 2024, 17 régions françaises sur 18 (à l'exception de la Guyane) avaient lancé leur COP. Ces événements ont tous été coanimés par les préfets de région, ainsi que les présidents de région. À ces représentants institutionnels se sont associés, comme l'expliquait le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu à l'époque du lancement des COP régionales, "tous les niveaux de collectivités et les acteurs du territoire de chaque secteur".
Ces COP régionales mobilisent ainsi l'ensemble des acteurs du territoire, à savoir les préfectures, les administrations, les conseils régionaux ou départementaux, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les communes, mais également les acteurs du monde économique, comme les représentants des entreprises du secteur industriel et agricole, ainsi que les acteurs de la société civile, associations environnementales, associations de consommateurs, étudiants, jeunes, etc. Par exemple, en Centre-Val de Loire, une cinquantaine de lycées y ont pris part.
Comment fonctionnent-elles ?
L'objectif de ces COP est de doter l'ensemble du territoire national d'"un plan concret, collectif et crédible pour réussir sa transition écologique", explique le ministère. Dans le détail, chaque région a reçu, lors du lancement de sa COP, un "Mondrian", un tableau recensant tous les objectifs prévisionnels sur lesquels elle peut s'appuyer pour effectuer sa transition écologique. Selon le Secrétariat général à la planification écologique (SGPE), "le partage de ces Mondrians à la maille régionale, c'est-à-dire des baisses quantifiées de GES par levier issues de la Stratégie nationale bas-carbone, et réparties par région, a permis à chacune d'entre elle de visualiser ce que pourraient être ses objectifs, en cohérence avec les objectifs nationaux".
Quant à la méthode employée, elle repose sur quatre étapes. Tout d'abord, il y a le "diagnostic" effectué conjointement par l'ensemble des participants, avec la présentation de l'ensemble des actions réalisées ou en cours. Dans un second temps, des débats entre les acteurs territoriaux sont proposés autour d'objectifs concrets à atteindre. Un partage à l'échelle des territoires infrarégionaux est organisé, afin d'aboutir à l'élaboration d'une feuille de route régionale à l'horizon 2030, couvrant six thématiques : "Mieux se loger", "Mieux se déplacer", "Mieux se nourrir", "Mieux produire", "Mieux consommer" et "Mieux préserver".
Que faut-il retenir de cette première saison ?
Pour le Secrétariat général de la planification écologique, l'heure est désormais au bilan de cette saison 1. Le 10 février dernier, un premier rapport a été tiré de toutes les feuilles de route réceptionnées. Seules celles de l'Île-de-France, de la Bretagne, Mayotte et la Guyane manquaient encore à l'appel. Premier constat : "la démarche de la COP a trouvé une adhésion très nette des acteurs", avec plus de 120 groupes de travail et plus de 3 000 participants, s'est félicité le SGPE. Ces "COP 2024 ont permis une appropriation structurée des objectifs de la planification écologique nationale sur les volets de l’atténuation, de la préservation des ressources et de la biodiversité".
Dans le détail, l'ensemble des régions s'est saisi des leviers les plus importants en termes d'impact sur les gaz à effet de serre. Les COP, selon le SGPE, ont déployé de "nouveaux efforts ou permis d'amplifier des efforts existants", notamment la décarbonation des 50 sites industriels les plus émetteurs, ou encore l'électrification des transports. Un second levier a été saisi par les régions, celui du bâtiment, "bien qu’on puisse regretter un manque de ciblage explicite des changements de vecteurs (fioul/gaz)", peut-on notamment lire dans le rapport. Autre levier également plébiscité : la gestion durable des forêts. Enfin, et ce malgré les débats actuels autour de la loi ZAN (Zéro artificialisation nette), les principes de sobriété foncière ont aussi été retenus, illustration "de son importance au niveau local".
Lors des prochaines COP régionales, les feuilles de route seront amenées à évoluer car "la COP2 ambitionne d’intégrer de nouvelles actions relevant du volet adaptation". D'ailleurs, certaines régions ont déjà identifié des thématiques peu ou pas assez traitées dans la COP1, comme par exemple l’agriculture, et ont d'ores et déjà prévu de les remettre au débat en 2025 afin de les intégrer à leur nouvelle feuille de route.