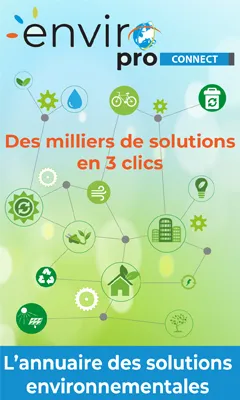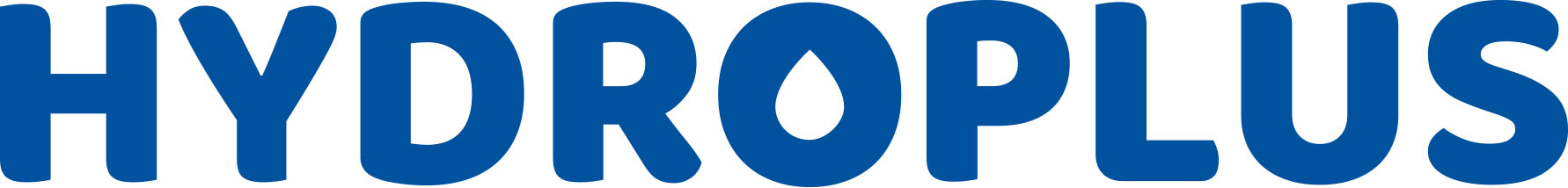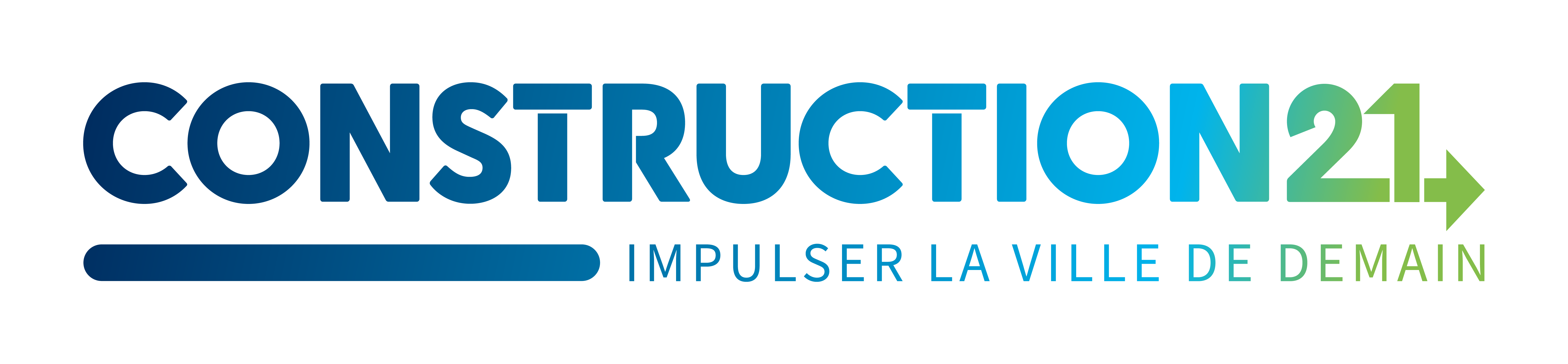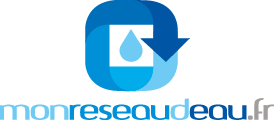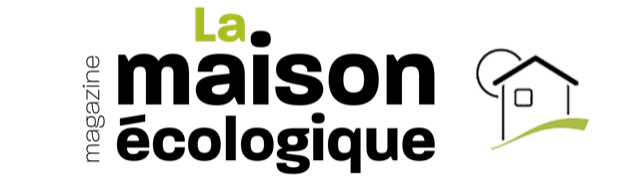Le salon des Solutions
environnementales & énergétique du
Grand Est
Les Actualités
Produire des protéines à partir de biodéchets : des bénéfices environnementaux limités
02/04/2025

© Iryna
Afin de limiter l'impact environnemental de la production de viande, de nombreuses alternatives se développent tirant partie des protéines présentes dans les biodéchets. Dans une étude comparative, l'Inrae doute de leurs bénéfices environnementaux.
Déchets verts, agricoles, de cuisine, de l'industrie agroalimentaire… Tous ces déchets dits organiques peuvent bénéficier d'une valorisation matière ou énergétique. Le compostage ou la méthanisation sont les techniques les plus utilisées pour le réaliser. Mais de nouvelles voies de valorisation émergent, celles de la fabrication d'ingrédients alimentaires, tirant partie des protéines présentes dans ces biodéchets.
L'exemple le plus parlant est sans doute l'élevage d'insectes nourris par des déchets organiques, mais il existe d'autres procédés, notamment des bioraffineries, capables d'extraire les protéines des résidus végétaux ou de faire produire des protéines par des microorganismes dans des réacteurs biologiques. « La transformation de biorésidus sous-utilisés en nouveaux produits destinés à l'alimentation humaine et animale, tels que les protéines fongiques, les protéines microbiennes et les insectes, représente une voie de transformation des déchets en nutriments (1) de plus en plus encouragée pour réduire les impacts environnementaux des systèmes alimentaires, notamment les pressions sur le changement climatique, les terres et les ressources en eau, constate une équipe de recherche de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae) sous la responsabilité d'Ugo Javourez, docteur en génie des procédés et de l'environnement au sein du TBI, Toulouse Biotechnology Institute. Cependant, le potentiel réel d'atténuation environnementale de cette stratégie dépend des avancées technologiques futures et de facteurs contextuels, qui restent incertains », conclut l'équipe après la réalisation d'une étude comparative publiée dans Nature Sustainability (2) .
L'acceptation sociétale, une condition majeure
“ Le potentiel réel d'atténuation environnementale de cette stratégie dépend des avancées technologiques futures et de facteurs contextuels, qui restent incertains ”
L'équipe de chercheurs de l'Inrae
Les scientifiques ont ainsi comparé cinq de ces technologies : l'élevage d'insectes, la fermentation solide (transformation des coproduits alimentaires par des levures), l'extraction de protéines végétales, la production de mycoprotéines (protéines produites par des champignons) et de protéines microbiennes. L'étude a consisté à réaliser une analyse de cycle de vie de 8 820 combinaisons d'efficacités futures des procédés, à travers neuf scénarios de systèmes alimentaires et énergétiques et sur la base de onze résidus organiques représentatifs en France. Le tout en comparant leur impact environnemental à celui des technologies de valorisation des déchets existantes, comme la méthanisation, le compostage ou l'alimentation d'animaux directement à partir de coproduits agricoles et alimentaires. Pour l'analyse du cycle de vie (ACV), plusieurs indicateurs environnementaux ont été retenus : les émissions de gaz à effet de serre (GES), l'eutrophisation marine et l'utilisation des terres et de l'eau.
« Globalement, la transformation des biorésidus en nouveaux ingrédients n'est compétitive que sous certaines conditions, notamment l'accès à une énergie décarbonée, des avancées technologiques substantielles et des scénarios où de nouveaux ingrédients remplacent la viande plutôt que l'alimentation animale », concluent les chercheurs. Leur étude montre que l'efficacité environnementale de ces nouvelles technologies est variable et dépend largement de l'acceptation des consommateurs. Par exemple, il faudrait que les protéines issues des insectes ou des micro-organismes remplacent au moins 80 % du poids de la viande produite et consommée pour que ces technologies soient réellement avantageuses sur le plan environnemental. Ce qui est encore loin d'être le cas, même si l'Union européenne autorise progressivement l'usage de farine d'insectes dans l'alimentation.
Un intérêt carbone moindre que la lutte contre le gaspillage
En effet, selon l'étude de l'équipe d'Ugo Javourez, les bénéfices pour le climat de produire de nouveaux ingrédients par les technologies waste-to-nutrition sont minorés par les émissions générées par les processus de transformation, notamment la consommation d'énergie. Même dans les meilleurs scénarios, la contribution de ces technologies à l'atténuation du changement climatique reste nettement inférieure à des stratégies comme la réduction du gaspillage alimentaire ou la diminution de la consommation de viande. Ainsi, à l'échelle française, l'analyse et les calculs montrent que, dans le meilleur scénario, les technologies waste-to-nutrition peuvent réduire les émissions de GES jusqu'à 10 MtCO2eq. Ce chiffre reste très inférieur aux stratégies de réduction du gaspillage alimentaire (qui pourraient réduire jusqu'à 15 MtCO₂eq les émissions de GES) ou celles de diminution de la consommation de viande (entre 20 et 25 MtCO₂eq de réduction potentielle des émissions de GES).
1. Lire l'un des blogs de nos abonnés
2. Javourez U. et al. (2025). Environmental mitigation potential of waste-to-nutrition pathways. Nature Sustainability. DOI : 10.1038/s41893-025-01521-z
Florence Roussel / actu-environnement