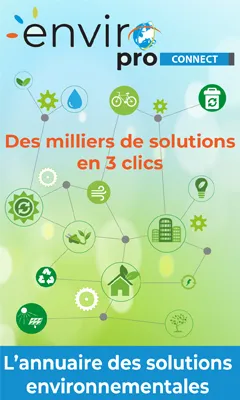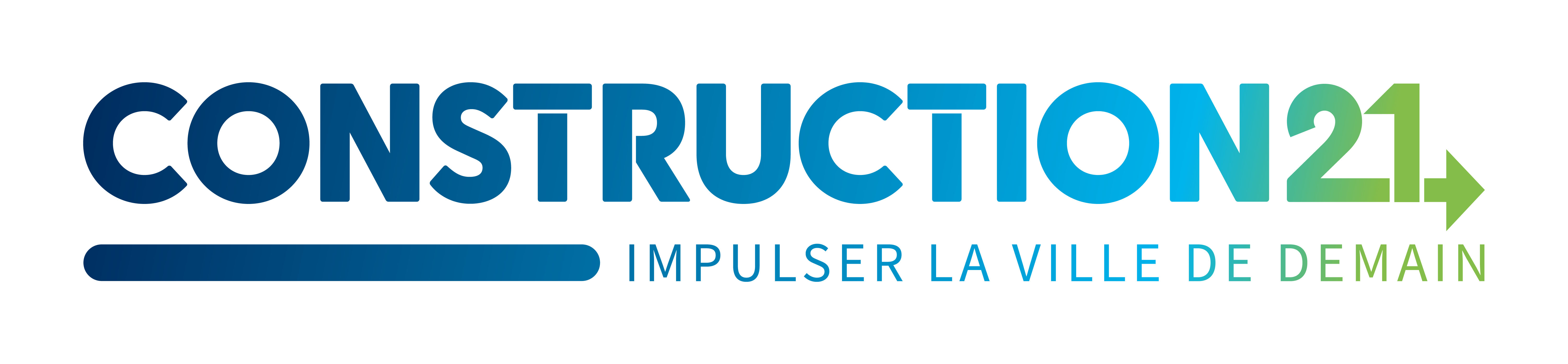Le salon des Solutions
environnementales & énergétique du
Nord
Les Actualités
La transition électrique des VUL avance, mais cale sur la fiscalité
05/04/2025

L’offre de VUL électriques s’étoffe, mais la demande peine à suivre. Manque d’aides stables, fiscalité peu avantageuse, hésitations des TPE… Le chemin vers le 100 % électrique reste semé d’embûches.
Alors que les objectifs européens imposent un passage au zéro émission pour les VUL neufs d’ici à 2035, la transition du marché français reste laborieuse. Les professionnels, freinés par un cadre fiscal peu incitatif et des aides complexes à mobiliser, peinent encore à s’équiper.
Alors que la France s’est engagée à ne plus commercialiser de véhicules utilitaires légers thermiques neufs à partir de 2035, la transition vers l’électrique reste contrastée. Si l’offre industrielle progresse rapidement, les entreprises, premiers utilisateurs de ces véhicules, font face à des freins fiscaux et économiques qui ralentissent la conversion du parc.
Avec 6,5 millions d’utilitaires légers en circulation à fin 2024, la France détient le parc le plus important d’Europe. Ces véhicules, indispensables au fonctionnement de nombreux secteurs professionnels, contribuent pourtant à hauteur de 16 % aux émissions de gaz à effet de serre du transport, soit 5 % des émissions nationales. Leur impact sanitaire est également significatif : un utilitaire émet en moyenne trois fois plus de NOx et deux fois plus de particules fines PM10 qu'une voiture, selon une étude citée dans le briefing publié par Transport & Environment.
Face à ce constat, l’électrification du segment s’impose comme une priorité. La réglementation européenne fixe une trajectoire de décarbonation ambitieuse : les émissions moyennes des VUL neufs devront tomber à 91 g de CO2/km en 2030, avant d’être nulles en 2035. La tendance est enclenchée, mais encore timide. En 2024, seuls 7 % des VUL neufs immatriculés en France étaient électriques, contre 78 % au diesel.
Une offre étoffée mais une fiscalité peu lisible
Pourtant, l’offre s’élargit : 43 modèles zéro émission sont déjà disponibles, un chiffre qui dépassera celui des modèles thermiques d’ici à 2026. L’autonomie des utilitaires électriques couvre la majorité des usages professionnels (entre 230 et 330 km pour la plupart), et le coût des batteries amorce une baisse. À horizon 2027, le prix d’achat des modèles électriques pourrait devenir compétitif par rapport au diesel, à condition que la taille des batteries reste contenue.
Mais du côté de la demande, les signaux sont plus contrastés. Les entreprises représentent 90 % des immatriculations de VUL neufs, mais leur comportement d’achat reste hétérogène. Les grandes entreprises sont les plus actives sur le marché du neuf, tandis que les TPE privilégient l’occasion. Le secteur du BTP, par exemple, qui concentre un quart du parc professionnel, repose en grande majorité sur des entreprises de moins de 50 salariés. Or, ces structures peinent à absorber le surcoût des véhicules électriques, en l’absence d’aides ciblées et stables.
Le remplacement du bonus écologique par des aides issues du dispositif des certificats d’économies d’énergie n’a pas facilité les choses. Jugé complexe à mobiliser, ce mécanisme accorde une subvention de 2 600 à 4 390 euros selon la taille de la flotte. En parallèle, les VUL électriques ne bénéficient pas des mêmes avantages fiscaux que les voitures électriques, que ce soit en matière d’amortissements, de taxes sur les véhicules de société ou d’avantages en nature. Résultat : le coût total de possession d’un utilitaire électrique reste souvent défavorable.
Un levier industriel stratégique pour l’automobile française
Pour les acteurs de la filière, l’enjeu dépasse la simple transition énergétique. Les VUL constituent un maillon stratégique de l’industrie automobile française. En 2024, 38 % des utilitaires neufs immatriculés dans l’Hexagone étaient assemblés localement, un taux bien supérieur à celui des voitures particulières. Trois constructeurs français – Renault, Peugeot et Citroën – dominent le marché, avec 62 % de part de marché à eux seuls.
Cette mutation suppose un accompagnement plus clair des acteurs économiques. Une série de propositions a été formulée dans le document de T&E : maintien des objectifs européens, incitations fiscales renforcées, création d’un éco-score dédié, analyses filières par filière, et contribution des plateformes de e-commerce au financement des transports publics via une taxation des livraisons urbaines.