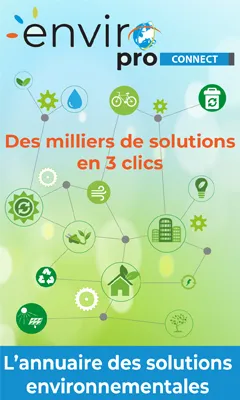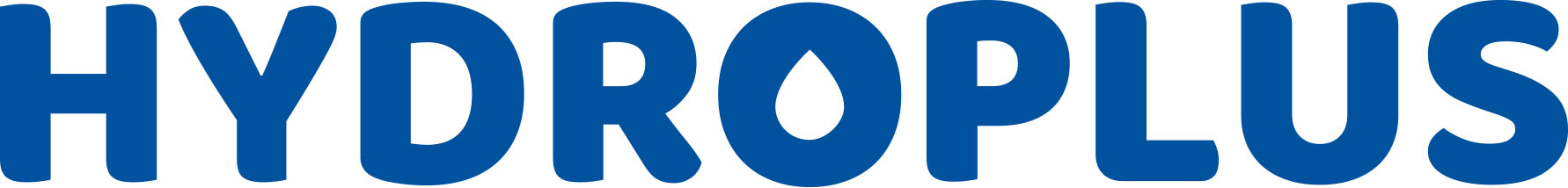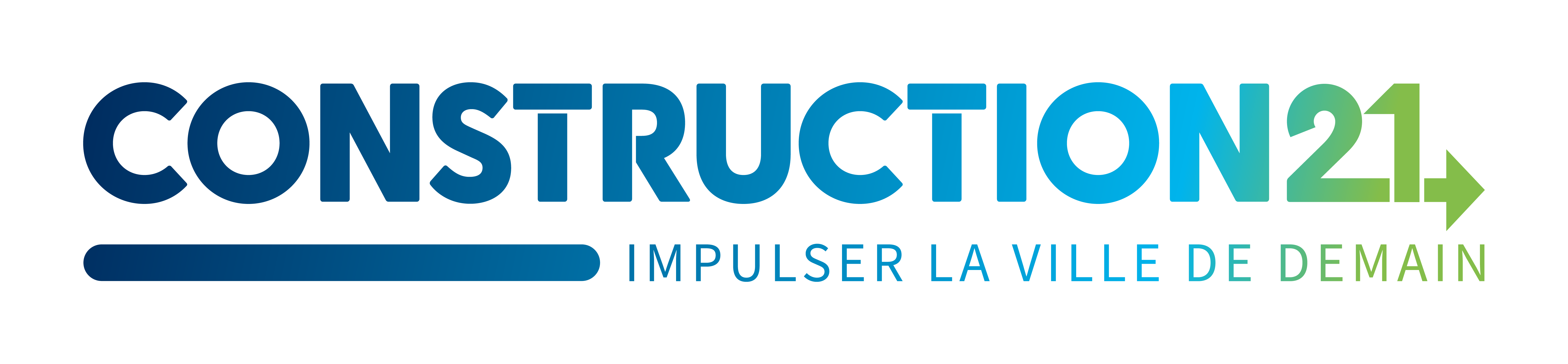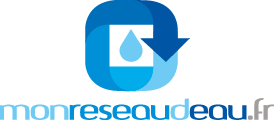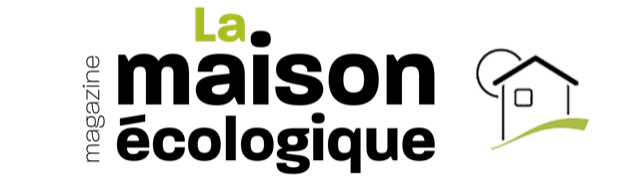Le salon des Solutions
environnementales & énergétique du
Grand Est
Les Actualités
La Terre se réchauffe « plus rapidement que jamais »
16/06/2024

Pakistan, le 31 mai 2024. Quelques jours plus tôt, les températures avaient dépassé les 52 °C au sud du pays. - © Arif Ali / AFP
Selon une étude publiée le 5 juin, mettant à jour les données du Giec, la Terre s’est réchauffée de 0,26 °C en dix ans. Un record. Et le seuil des +1,5 °C se rapproche dangereusement.
Le Mexique, le Pakistan et l’Inde subissent des vagues de chaleur mortelles ; les forêts californiennes sont dévastées par les incendies ; le nord de l’Europe vient de vivre de multiples inondations... Ces instantanés nous rappellent, si besoin est, que le changement climatique n’offre aucun répit. Même, il s’amplifie à un rythme sans précédent.
C’est ce que révèle le deuxième rapport sur les indicateurs du changement climatique mondial (IGCC), publié le 5 juin dans le journal Earth System Science Data (ESSD). « Le seuil le plus ambitieux de l’Accord de Paris, à savoir limiter le réchauffement des températures globales à 1,5 °C, se rapproche dangereusement », prévient Aurélien Ribes, chercheur au Centre national de la recherche météorologique (CNRM), dans un communiqué.
Les températures se réchauffent « plus rapidement que jamais »
Piloté par l’Université de Leeds, avec le soutien de plus de cinquante scientifiques de renom, ce rapport met à jour les principaux résultats du rapport du groupe de travail 1 du Giec (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) paru en 2021, dédié aux bases physiques du changement climatique.
Les résultats qu’il contient sont cinglants : le réchauffement des températures au niveau mondial, provoqué par les activités humaines, a progressé de 0,26 °C sur la décennie 2014-2023. Soit le taux le plus élevé constaté depuis le début des relevés. Depuis la période préindustrielle, les températures moyennes ont augmenté de 1,19 °C. Un chiffre revu à la hausse par rapport aux 1,14 °C observés entre 2013 et 2022 — qui ne comptait donc pas l’année 2023, exceptionnellement chaude.
« Les températures mondiales continuent d’évoluer dans la mauvaise direction, et ce plus rapidement que jamais », résume Piers Forster, coordinateur du rapport et directeur du Priestley Centre for Climate Futures de l’université de Leeds. Selon l’IGCC, en 2023, soit en une seule année, la hausse des températures a atteint 1,43 °C en moyenne [1], par rapport à la période préindustrielle. Il s’agissait de l’année la plus chaude jamais enregistrée, marquée par le retour du phénomène météorologique super-réchauffant El Niño. Même en écartant la variabilité naturelle liée à El Niño, les chercheurs estiment que le réchauffement lié aux activités humaines était de 1,3 °C cette année-là.
Cette accélération est liée à des émissions de gaz à effet de serre toujours aussi élevées, sous l’effet des activités humaines, notamment la déforestation et l’exploitation des combustibles fossiles comme le charbon, le pétrole et le gaz. Elles sont équivalentes à 53 milliards de tonnes de CO2 par an.

L’accélération du réchauffement est liée aux émissions de gaz à effet de serre dues aux activités humaines, notamment l’exploitation des combustibles fossiles comme le charbon, le pétrole et le gaz. Pxhere
Les concentrations des principaux gaz à effet de serre dans l’atmosphère, qui font s’emballer le système climatique, atteignent donc des sommets. 419,3 parties par million (ppm) pour le dioxyde de carbone (CO2) – contre 410,1 ppm dans le rapport du Giec de 2021 (soit le nombre de molécules de CO2 présentes pour un million de molécules de tous les constituants présents dans l’air). Une valeur inédite depuis plus de 2 millions d’années. 1 922,5 parties par milliard (ppb) pour le méthane et 336,9 ppb pour le protoxyde d’azote. Le système climatique s’emballe sous l’effet de ce surplus d’énergie.
Autre donnée, a priori paradoxale. Les aérosols, créés par les activités polluantes, permettent néanmoins de réfléchir une partie des rayons du soleil vers l’espace. Et donc de refroidir la planète. Or, grâce aux efforts mondiaux pour améliorer la qualité de l’air, il y en a moins. La baisse de ces particules en suspension dans l’atmosphère, comme le soufre émis par le transport maritime, a donc pu jouer un rôle dans le réchauffement du climat, indiquent les chercheurs.
Quelle marge de manœuvre reste-t-il ?
La question qui se pose désormais est la suivante : quelle marge de manœuvre reste-t-il pour contenir l’augmentation des températures globales sous les 1,5 °C, seuil fixé par l’Accord de Paris pour éviter des conséquences incommensurables ? L’IGCC estime que notre budget carbone résiduel, c’est-à-dire les émissions à ne pas dépasser pour conserver 1 chance sur 2 de rester sous les 1,5 °C, est d’environ 200 milliards de tonnes de CO2, soit l’équivalent d’environ cinq années d’émissions au rythme actuel. Il était d’environ 500 milliards dans l’évaluation du Giec en 2021.
Comme l’indiquait le dernier rapport du Giec, le réchauffement va se poursuivre quoi qu’il arrive à court terme, jusqu’en 2040, et la limite de 1,5 °C pourrait être franchie au début des années 2030. Ce sont nos actions actuelles qui vont déterminer l’ampleur du changement climatique à plus long terme. Or, aujourd’hui, le compte n’y est pas. Selon le rapport de l’ONU sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions, les engagements des pays mènent la planète vers un réchauffement de 2,5 à 2,9 °C d’ici la fin du siècle.
« Les voyants du tableau de bord clignotent en rouge »
« Cette deuxième mise à jour du rapport du Giec met en évidence l’intensification rapide de l’influence des activités humaines sur le climat, observe Valérie Masson-Delmotte, chargée de recherche au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA). La gravité des conséquences observées ces derniers mois, la chaleur intense sur terre et en mer, les précipitations extrêmes, la sécheresse, les incendies, et leurs effets sur les écosystèmes, les infrastructures et l’économie, nous rappelle pourquoi la moindre augmentation du réchauffement est désastreuse. »
« Les voyants du tableau de bord clignotent en rouge. Sans mesures significatives, les choses vont continuer d’empirer, de plus en plus vite », réagit Peter Thorne, directeur du centre de recherche climatique Icarus. Cette mise en garde intervient alors que les représentants de près de 200 pays sont actuellement réunis à Bonn (Allemagne), jusqu’au 13 juin, pour préparer la prochaine conférence mondiale sur le climat (COP29), qui se tiendra en novembre à Bakou, en Azerbaïdjan.
Ce nouveau rapport s’accompagne aussi d’une plateforme de données et de sciences ouvertes : le Climate Change Tracker, qui permet d’accéder facilement à des informations actualisées sur les principaux indicateurs climatiques.