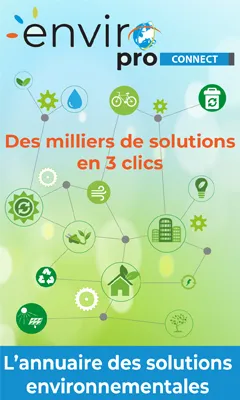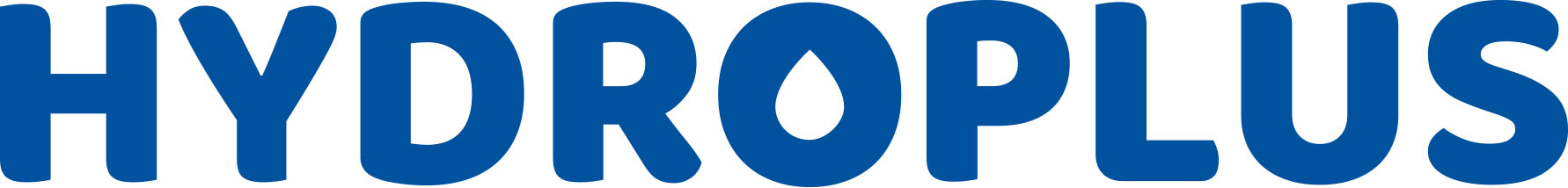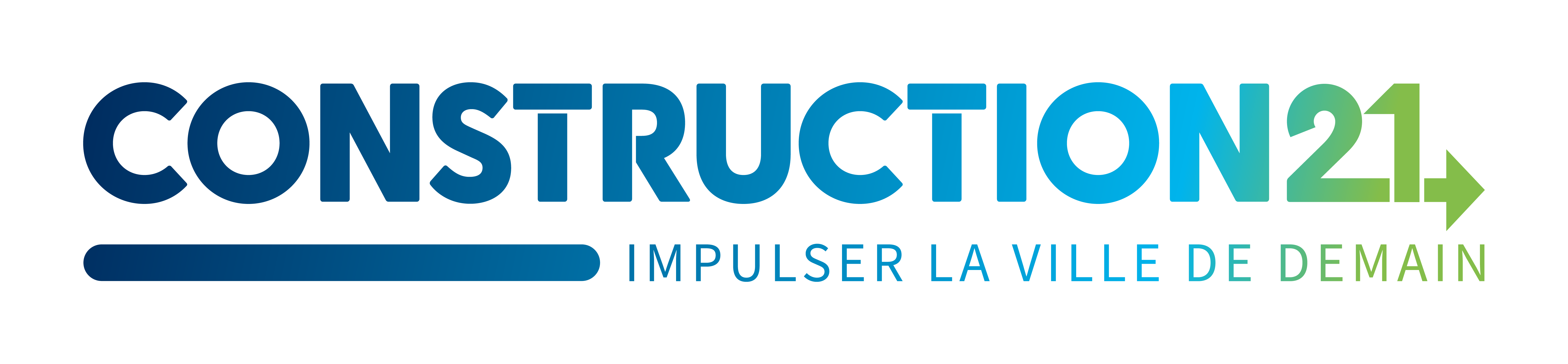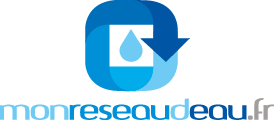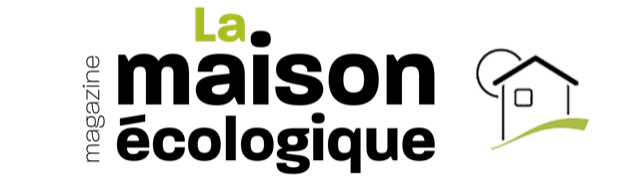Le salon des Solutions
environnementales & énergétique du
Grand Est
Les Actualités
L'écoproduction ou quand le cinéma fait sa transition écologique
16/02/2025
Parvenir à la neutralité carbone en 2050 ne se fera pas sans tous les secteurs de l'économie, y compris l'industrie audiovisuelle. Pour ce faire, films, séries et autres productions sont de plus en plus nombreux à se tourner vers l'écoproduction.
Les objectifs de la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) touchent tous les secteurs de l'économie. L'industrie audiovisuelle – et ses 1,7 million de tonnes équivalent dioxyde de carbone (CO2) annuelles, selon l'Agence de la transition écologique (Ademe) – n'y échappe pas. Et si certains grands studios sont déjà confrontés à l'obligation de faire leur comptabilité carbone pour répondre aux directives européennes, la France a pris le parti de l'imposer à tous les projets.
Depuis le 1er janvier 2024, le code du cinéma (1) oblige ainsi chaque production en prises de vues réelles (films, séries, clips, publicités) sollicitant une aide financière du Centre national du cinéma (CNC) à lui fournir un bilan carbone prévisionnel, avant le tournage, et un bilan carbone définitif, une fois l'œuvre achevée. Pour l'instant, cette « écoconditionnalité », qui s'étendra également aux œuvres animées et aux jeux vidéos à partir du 1er mars 2025, ne va pas jusqu'à exiger de réduire cet impact.
Les dessous de l'écoproduction
Cela étant, un nombre croissant de productions, politiquement engagées ou simplement soucieuses de soigner leur image commerciale, tentent de montrer l'exemple. C'est ce que le monde audiovisuel appelle « l'écoproduction ». Cette pratique consiste à jouer sur toutes les dimensions d'une œuvre audiovisuelle : opter pour des lumières et des caméras avec plus d'efficacité énergétique ; réutiliser les costumes et recycler les décors ; optimiser les lieux de tournage pour réduire le poids des transports et composer des menus plus sobres pour ravitailler les équipes.
Évidemment, la liberté créative ou artistique demeure maître, mais certains chargés d'écoproduction parviennent à influer légèrement sur le scénario ou la réalisation d'une œuvre pour la rendre plus écologique sans en changer le sens. À tel point que l'association Ecoprod, qui réunit de nombreux acteurs du secteur, a souhaité valoriser les bons élèves à travers la présentation de labels d'écoproduction à faire figurer sur les affiches promotionnelles des œuvres récompensées. « Il ne faut pas que les productions s'arrêtent à mesurer leur impact, il faut qu'elles arrivent surtout à le réduire, martèle Alissa Aubenque, directrice des opérations d'Ecoprod. L'écoproduction ne coûte pas nécessairement plus cher, mais cela demande du temps et éventuellement l'embauche d'une personne en plus [comme un chargé d'écoproduction, ndlr]. Mais cela conduit ensuite à baisser les coûts de production. »
Réalisation & Montage : Romain Pernot
1. Accéder à l'article 122-18 du Code du cinéma
Félix Gouty / actu-environnement