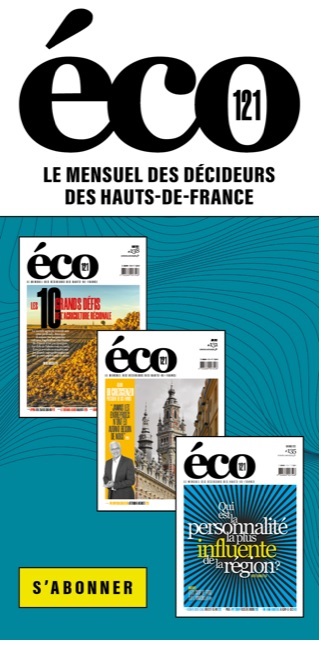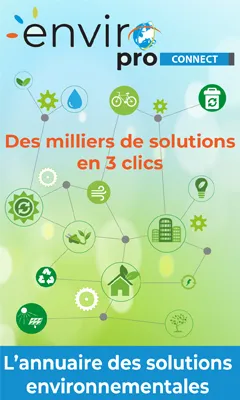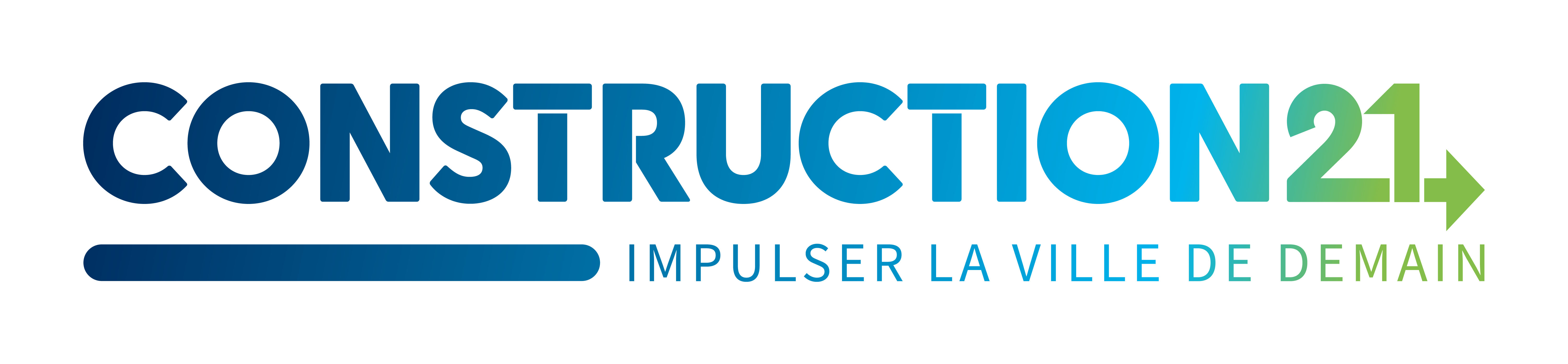Le salon des Solutions
environnementales & énergétique du
Nord
Les Actualités
Réchauffement climatique : une étude américaine estime qu'il est trop tard pour le limiter à 2 °C
15/02/2025

James Hansen et ses collègues estiment que le palier de 2°C sera atteint dès 2045. © st__iv
D'après le célèbre climatologue James Hansen et ses collègues, les projections climatiques montrent que le second palier de l'Accord de Paris n'est plus atteignable en temps voulu et qu'un recours à la géoingénierie mérite réflexion.
« Échouer à donner une vision réaliste du réchauffement climatique et à dénoncer la faiblesse des politiques actuelles ne sont d'aucune aide pour les générations futures », martèlent des chercheurs américains dans une étude (1) publiée, le 3 février, dans la revue Environment – Science & Policy for Sustainable Development. Parmi eux : James Hansen, climatologue de renom aujourd'hui professeur de l'université de Columbia. Et pour lui, le constat est sans appel. « L'objectif d'un réchauffement limité à 2 °C en 2100 est mort, parce que la consommation d'énergies fossiles continue d'augmenter et ne s'arrêtera pas », avance-t-il au journal britannique The Guardian.
L'ancien directeur de l'Institut Goddard des études spatiales de l'Agence spatiale américaine (Nasa) de 1981 à 2013 reste célèbre pour son intervention devant le Congrès américain en juin 1988, au sujet de la destruction de la couche d'ozone et d'un épisode exceptionnel de sécheresse. Il y avait exposé les conclusions de ses modélisations climatiques, arguant que l'influence humaine surpasserait celle de la variabilité naturelle à l'égard du réchauffement climatique à l'œuvre. Dans l'état des lieux publié aujourd'hui, James Hansen et ses collègues estiment que le palier de 2 °C sera atteint dès 2045. D'après eux, une telle accélération résulte principalement de deux facteurs : une croissance du forçage radiatif provoqué par les gaz à effet de serre d'origine anthropique et la disparition de l'effet aérosol des émissions de soufre issues du transport maritime.
Le paradoxe de la pollution atmosphérique
“ Sans l'effet compensateur des aérosols maritimes, le réchauffement des vingt prochaines années devrait s'établir entre 0,2 et 0,3 °C par décennie ”
Les chercheurs américains
« Le rythme de réchauffement établi en moyenne à 0,18 °C de plus par décennie entre 1970 et 2010 est moins que ce qu'aurait causé les gaz à effet de serre à eux seuls sans l'effet compensateur des aérosols maritimes, expliquent les chercheurs. Sans ce dernier, le réchauffement des vingt prochaines années devrait s'établir entre 0,2 et 0,3 °C par décennie. » D'après leur modélisation, la réduction des émissions de soufre provenant des navires – en respect de nouvelles normes de pollution de l'air instaurées par l'Organisation maritime internationale (OMI) depuis 2020 – aurait réhaussé le forçage radiatif de 0,5 watt par mètre carré (W/m2), au regard des dernières évaluations satellitaires de l'albédo (la capacité d'une surface, en l'occurrence celle de la Terre, à renvoyer le rayonnement solaire). C'est-à-dire bien plus que les précédentes estimations, oscillant entre un gain de 0,07 à 0,15 W/m2. De quoi pousser davantage le système climatique planétaire vers un « point de non-retour », comme le dérèglement du courant méridien de retournement de l'Atlantique (Amoc) « probablement dans vingt ou trente prochaines années ».
Face à un tel constat, les chercheurs invitent à considérer sérieusement le rapport bénéfice-risque d'une « intervention climatique », à savoir d'une forme de géoingénierie pour reproduire manuellement l'effet aérosol dans la stratosphère. Sans vouloir soutenir cette solution ouvertement, les auteurs suggèrent d'employer cette méthode « seulement pour éviter un dépassement temporaire d'un point de bascule » et « tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre aussi rapidement que possible ». Néanmoins, nuancent-ils, « même dans le pire des cas, où la baisse des émissions se troque contre de la géoingénierie, cette solution est un risque qui mérite réflexion compte tenu du potentiel désormais limité de la seule baisse des émissions sur l'éventualité d'une catastrophe climatique ».