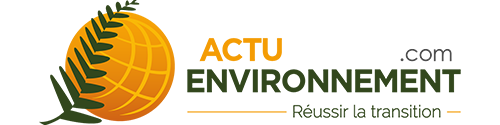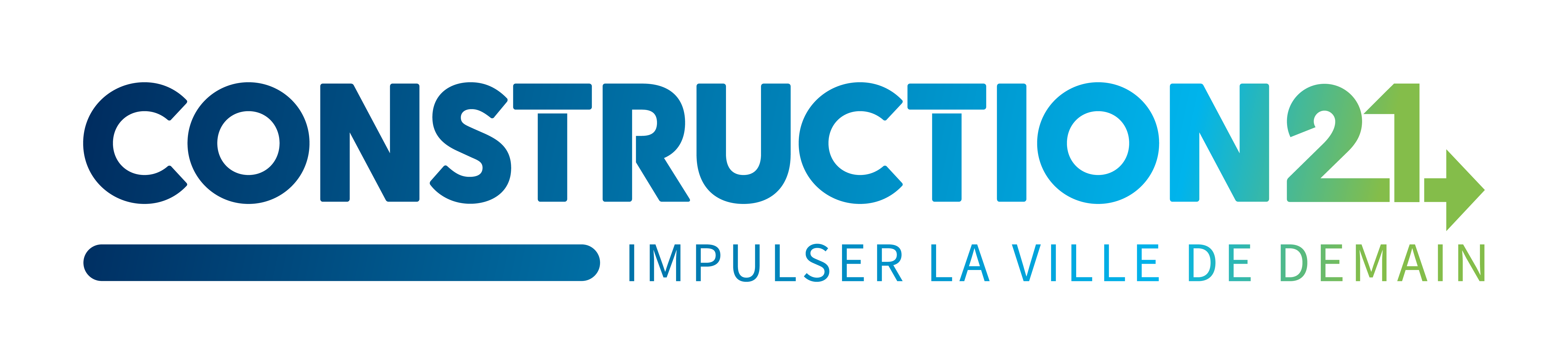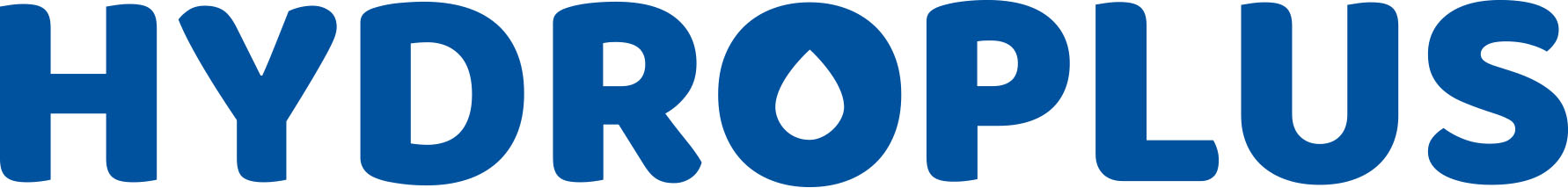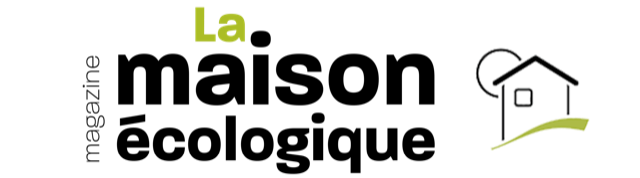Le salon des Solutions
environnementales & énergétique du
Grand Ouest
Les Actualités
Spirale climatique, émissions de co2... l'état de la planète en cinq datavisualisations de la NASA
19/08/2023

Novethic a sélectionné 5 datavisualisations de la NASA sur le réchauffement climatique. @NASA
Ce sont des datavisualisations chocs et pédagogiques que publie depuis des années la Nasa sur la crise climatique. La montée des eaux à travers un hublot, une spirale climatique qui montre l'évolution des températures, des nuages de CO2 rendant visibles l'invisible au-dessus de l'hémisphère nord... Novethic a sélectionné 5 visualisations pour comprendre l'état de la planète.
La montée du niveau de la mer depuis un hublot
Centimètre après centimètre, l'eau monte. Pour s'en rendre compte avec précision, la Nasa nous plonge au large devant un hublot fixe et fait défiler les années. En trente ans, le niveau de l'océan s'est élevé de 10 centimètres. Et le rythme s'accélère avec une augmentation de 3,6 centimètres durant la dernière décennie. Le GIEC prévoit dans son scénario le plus pessimiste une augmentation de 1 mètre du niveau des eaux d’ici 2100.
Certains pays craignent déjà d'être engloutis par les eaux. Le ministre des affaires étrangères de l'archipel des Tuvalu, au cœur de l'océan pacifique, avait marqué les esprits lors de la COP26 par un discours les pieds dans l'eau. En France aussi, 15 000 biens immobiliers récemment vendus sont menacés d'inondation d'ici 2050. Mais il est encore possible de ralentir la progression de la hausse du niveau de la mer et de trouver des solutions d'adaptation. Le Vanuatu, petit Etat composé de 83 îles, très exposé, remporte déjà des batailles juridiques au niveau international.
Une spirale climatique choc sur l'évolution des températures
1 minute et 10 secondes pour comprendre en un coup d’œil l’évolution des températures dans le monde depuis l’ère pré-industrielle. C’est la prouesse de cette "spirale climatique" publiée l’année dernière par la Nasa et toujours autant d’actualité. On constate ainsi que depuis l’ère préindustrielle, la Terre ne cesse de se réchauffer. Si le réchauffement était contenu jusque dans les années 1980, on observe une explosion à partir des années 2000.
Au total, depuis un siècle et demi, la température globale a ainsi crû de 1,2°C. Selon l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et le réseau européen Copernicus, l’Europe s’est réchauffé deux fois plus vite que le reste du monde avec des températures de +2,3°C au-dessus de la moyenne préindustrielle. Et la tendance ne s’inverse pas, au contraire. Copernicus vient ainsi de révéler que juillet 2023 était le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre. Quant à l’année 2023, c’est la troisième année la plus chaude jamais enregistrée à ce jour.
Les pôles, premières victimes du changement climatique
Aux deux extrémités de la planète, le constat est le même. Les pôles se dérèglent plus rapidement sous l’effet du changement climatique. D’ailleurs, le pôle Nord se réchaufferait même quatre fois plus, selon de récents travaux scientifiques. La raison ? Le phénomène "d’amplification polaire", qui fonctionne comme un cercle vicieux. En fondant, la glace et la neige, très réfléchissantes, sont remplacées par l'océan, plus sombre, qui absorbe donc davantage les rayons du soleil. Ainsi, les températures de l’air et de l’eau augmentent, et cela accélèrent la fonte.
De même, la banquise antarctique peine à se reconstituer malgré l’arrivée de l’hiver dans l’hémisphère Sud. Selon les chiffres du National Snow and Ice Data Center (NSIDC), l’étendue de glace couvrait quelque 14 millions de km2, le 25 juillet dernier, le niveau le plus bas enregistré à date équivalente.
La Terre étouffée sous les émissions de CO2
Parmi ses dernières visualisations, la Nasa montre comment les émissions de CO2 s’accumulent dans l’atmosphère au cours d’une année (et plus précisément au cours de l’année 2021). Le dioxyde de carbone est aujourd’hui le principal gaz à effet de serre issu des activités anthropiques et responsable du réchauffement climatique. Cette vidéo montre également les diverses sources des émissions de CO2. Ce que nous voyons en jaune représente la combustion d’énergies fossiles d’origine humaine ; en rouge, il s’agit de la biomasse brûlée par l’homme ; en vert, le CO2 émis par les écosystèmes terrestres et enfin en bleu par l’océan.
Cette visualisation permet également de distinguer la différence entre l’hémisphère nord complètement étouffé par le CO2 et l’hémisphère sud. D'ailleurs, il est aussi plus facile d’identifier les "hotspots" d’émissions tels que la Chine, les Etats-Unis, l’Arabie Saoudite ou encore l’Europe. Mais petite particularité intéressante lorsque l’on s’attarde sur la région de l’Amazonie, on remarque que le CO2 a tendance à disparaître plus rapidement. Cela s’explique notamment par la capacité de la forêt à absorber ce gaz.
Sécheresses et inondations, des extrêmes climatiques de plus en plus intenses
Sécheresses et pluies diluviennes sont aussi le lot du dérèglement climatique. La Nasa souligne l'augmentation du nombre et de l'intensité de ces évènements extrêmes entre 2002 et 2022 dans une carte du monde. Les bulles rouges représentent les sécheresses et les bleues, les fortes pluies. L'évènement le plus extrême a eu lieu en Afrique centrale en 2019 avec des pluies torrentielles sur une longue période. Champs détruits, villes noyées... Les inondations ont été dévastatrices dans de nombreux pays.
Le lien entre l'intensification de ces évènements et l'activité humaine et établi avec un "haut niveau de confiance" selon le rapport de synthèse 2023 du GIEC. Peu de territoires dans le monde sont épargnés. Le GIEC indique qu'entre 3,3 et 3,6 milliards de personnes, soit plus de la moitié de l'humanité, vivent dans des zones fortement vulnérables au changement climatique.
La rédaction novethic