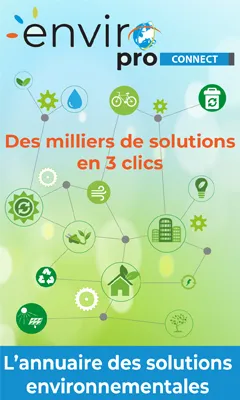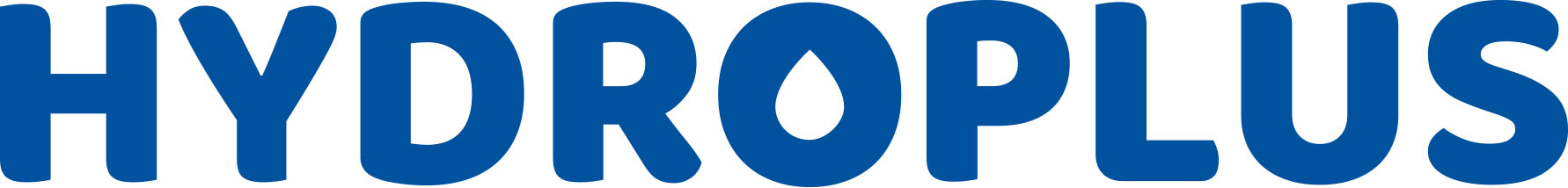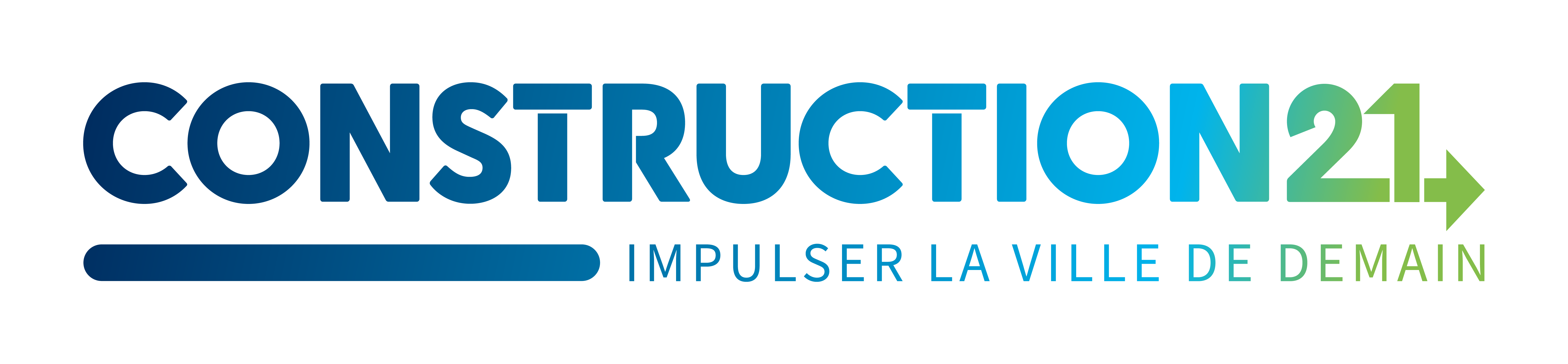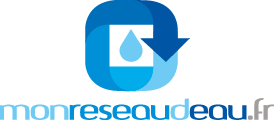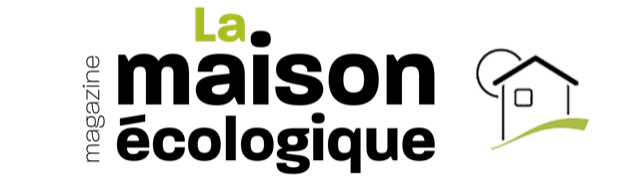Le salon des Solutions
environnementales & énergétique du
Grand Est
Les Actualités
Une nouvelle évaluation des puits de carbone remet en cause la prépondérance des forêts...
15/04/2025

Lac Télé en République du Congo (Congo-Brazzaville) © Yann Arthus-Bertrand
Une nouvelle évaluation des puits de carbone remet en cause la prépondérance des forêts au profit d’autres réservoirs comme les bassins d’eau de surface et les sols
Le stockage du carbone par les écosystèmes terrestres est souvent associé aux forêts, toutefois de récents travaux scientifiques remettent en perspective leur rôle dans l’absorption des émissions de gaz à effet de serre. En effet, selon une étude publiée dans la revue Science, les sols et les bassins d’eau de surface jouent un rôle prépondérant dans la captation et le stockage du CO2. « Des études récentes, dont la nôtre, montrent que les réservoirs de carbone ne se trouvent pas uniquement dans les forêts. Les forêts restent essentielles, mais il y a des gains importants dans le stockage du carbone au niveau mondial dans les bassins d’eau, dans les zones humides, dans les sols et dans les produits manufacturés issus du bois à condition qu’ils aient une durée de vie longue », explique Jean-Pierre Wigneron, co-auteur de l’étude et chercheur au sein de l’INRAE (l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement) Bordeaux sur les interactions sol plante atmosphère. Les forêts ne constitueraient en effet qu’un cinquième des puits terrestres de carbone.
Une augmentation des puits de carbone terrestre, mais un stockage réparti différemment
Entre 1992 et 2019, environ 35 gigatonnes de carbone ont été séquestrées sur la surface terrestre. Elle absorbe plus de gaz à effet de serre, ainsi elle captait 0,5 gigatonne de carbone par an au début des années 1990 contre 1,7 gigatonne par an à l’aube des années 2000. Cette accumulation de carbone terrestre a augmenté de 30 % sur la dernière décennie.
Les scientifiques ont étudié l’évolution du stockage du carbone au niveau terrestre entre 1992 et 2019. Leurs travaux montrent qu’en raison de la détérioration des forêts, ces dernières ne représentent que 6 % des gains dans le stockage du carbone. En clair, les sols, les surfaces d’eaux et zones humides et les produits issus du bois absorbent la majorité (94 %) des émissions supplémentaires. Durant les 30 dernières décennies, les rejets de gaz à effet de serre ont augmenté de près de 45 %.
La forêt n’est pas le seul milieu à pouvoir stocker le carbone
Les forêts ne sont donc pas le principal puit de carbone terrestre, mais elles ont un fort potentiel qui ne doit pas faire négliger la prise en compte des autres milieux naturels qui peuvent contribuer à l’atténuation des gaz à effet de serre ni leur protection. Jean-Pierre Wigneron précise en revanche que : « si on arrive à limiter la déforestation, les forêts pourront pleinement redevenir un réservoir de carbone très important. Il faut comprendre que notre étude est au niveau mondial, il y a donc des régions comme la Chine ou la Russie où les forêts progressent et absorbent du CO2 ; tandis qu’au Brésil, en Indonésie ou dans le Bassin du Congo, la déforestation libère du CO2. Les gains d’un côté sont contrebalancés par les pertes de l’autres ». Les activités humaines, le changement climatique, les sécheresses et les incendies font que la séquestration du carbone par les forêts n’augmente quasiment plus à un niveau global.
Il n’y a pas que les forêts pour compenser les émissions anthropiques
Au niveau mondial, la moitié des émissions de gaz à effet de serre finit dans l’atmosphère et réchauffe le climat tandis que les océans en absorbent environ 25 % et la surface terrestre le reste. Stocké dans les océans ou dans la biomasse ou le sol, le carbone ne contribue pas au dérèglement climatique, c’est pourquoi comprendre le cycle du carbone est important. Comme le rappelle Jean-Pierre Wigneron, « certaines formes de stockage du carbone sont plus pérennes. Par exemple, le carbone stocké dans les tourbières ou au fond des bassins d’eau sous forme de matières organiques inertes qui ne se dégradent pas peut durer des centaines d’années, alors que les forêts sont plus à risques. » Le chercheur plaide pour une meilleure protection des zones humides, des forêts et un usage durable des matériaux issus du bois : « en gros, il n’y a pas que les forêts pour nous sauver, il existe d’autres réservoirs de carbone qui sont conséquents. Jusqu’à présent, on ne mise presque que sur les forêts pour compenser les émissions anthropiques de carbone. Or, les zones humides, les lacs, les sols et les produits manufacturés ont aussi un rôle important dans l’atténuation de nos émissions. » Au-delà de l’atténuation, réduire à la source les émissions et mieux préserver la biodiversité demeurent des leviers majeurs de la lutte pour la préservation de l’environnement.
Julien Leprovost / goodplanet.info