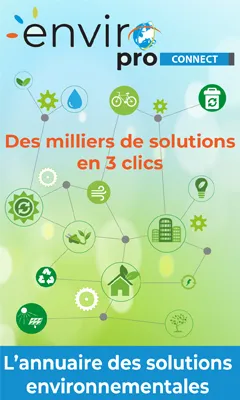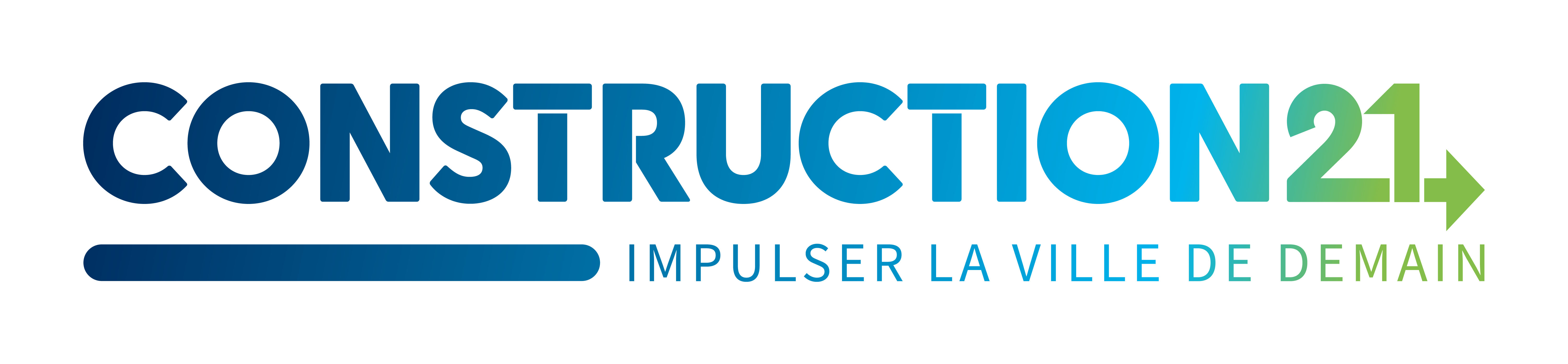Le salon des Solutions
environnementales & énergétique du
Nord
Les Actualités
Fret et logistique : le difficile virage vers la décarbonation
17/04/2025

Champion de la décarbonation, grâce à son fort potentiel de massification, le report modal vers le fer représente une autre voie à explorer. © GNT
Contributeur important au bilan carbone de la France, le secteur du fret et de la logistique cherche à alléger son empreinte, avec de nombreux leviers plus ou moins faciles à mobiliser selon les situations. Un chemin abrupt.
Pressés de décarboner leurs activités par l'Union européenne, par l'État français, par les chargeurs et même, parfois, par les consommateurs, les acteurs du fret et de la logistique se montrent volontaires. « Le secteur prend véritablement en main cette responsabilité, malgré ses difficultés, les fortes tensions géopolitiques et la hausse des prix du carburant, notamment, assure Laurence Gaborieau, directrice du Salon international du transport et de la logistique (SITL), qui s'est tenu du 1er au 3 avril, à Paris. Les dépôts de bilan n'ont jamais été aussi nombreux, mais les transporteurs continuent à investir et à innover. »
La démarche n'a pourtant rien d'un long fleuve tranquille. En raison de l'ampleur du défi à relever, tout d'abord. Responsable de 11 % des émissions de gaz à effet de serre du pays, jusqu'à 16 %, selon l'Ademe, en y ajoutant le stockage, les emballages et le déplacement des consommateurs pour l'achat du produit, la filière a totalisé 5 000 tonnes-kilomètres (t-km) par habitant en 2022, dont 88 % assurés par la route, le plus polluant des modes de transport. Un total en légère baisse à l'échelle strictement nationale, mais en augmentation pour l'international.
Cette hausse devrait se poursuivre. Selon la direction générale des Infrastructures, des Transports et des Mobilités (DGITM), elle atteindrait 4 % en 2030 par rapport à 2019 si elle était maîtrisée, 7,5 % dans le cas contraire. Or, à cet horizon, la Stratégie de développement des mobilités propres (SDMP) en consultation vise une réduction de 31 % des émissions de gaz à effet de serre du transport en général, par rapport à 2022, le fret représentant actuellement un tiers du total.
L'électrique à petite vitesse
Sauf nouveau changement de cap, la législation européenne impose, pour sa part, une réduction de 45 % des émissions de CO2 des gros camions pour la période 2030 à 2034. Aucun des leviers à la portée des professionnels ne peut permettre à lui tout seul d'atteindre tous ces objectifs, tant les contraintes s'avèrent nombreuses et diversifiées. Cependant, puisque le fret routier semble voué à demeurer largement prépondérant, l'électrification des camions apparait comme la solution la plus simple à mettre en œuvre. En 2050, selon le cabinet Carbone 4, cette motorisation pourrait équiper environ 90 % du parc roulant.
Aujourd'hui, les batteries offrent déjà des marges d'autonomie confortables, jusqu'à 600 km, et le réseau de bornes de recharge à très haute puissance s'étoffe. Grâce à l'accélération de la production des véhicules électriques, leur coût total de possession devient même intéressant dans certains cas. « Mais force est de constater que la France doit encore accélérer sur l'électrification, souligne Tristan Bourvon, coordinateur logistique et transport de marchandises de l'Ademe. Aujourd'hui, la part de marché des poids lourds électriques est de 1,4 %. Elle devrait être de 14 % l'année prochaine, selon le projet de Stratégie nationale bas carbone 3 et de 46 % en 2030. » On n'en compte ainsi pas plus de 3 000 en circulation contre un peu plus de 500 000 camions diesel, confirme Denis Choumert, vice-président de l'Association des utilisateurs de transport de fret (AUTF), « Ces véhicules restent chers à l'achat, l'installation de bornes de recharge également. »
Des solutions alternatives à la marge
En phase transitoire, les transporteurs pourraient se rabattre sur les biocarburants, moins émissifs que le gazole de 30 à 80 %, technologiquement mâtures et nécessitant moins d'adaptation matérielle. Le B100 issu du colza et le HVO à base d'huiles végétales rencontrent d'ailleurs un certain succès auprès de la profession. Mais à terme, juge Carbone 4, ces carburants provenant de ressources limitées couvriront moins de 10 % des besoins du secteur. Ils seront donc prioritairement fléchés vers la très longue distance, l'aérien et le maritime, de même que les e-fuels très énergétivores pour leur production. Quant à l'hydrogène, il ne jouera vraisemblablement qu'un rôle mineur, pour des usages très précis.
Afin d'encourager la bascule vers l'électrique, plusieurs pistes nouvelles restent à explorer, comme la modulation des tarifs autoroutiers selon la motorisation, proposée par la SDMP, ou le développement du rétrofit. La technologie émergente des autoroutes électriques, par rail, caténaires ou induction suscite aussi quelques espoirs. Mais ses coûts en infrastructures sont importants. Autre piste intéressante : le remplacement des tracteurs ou des batteries par des équipements déjà rechargés, évitant l'immobilisation de la marchandise. Ce swapping, requiert toutefois du foncier pour aménager les parkings. En revanche, ces deux solutions présentent bien des avantages : permettre une recharge domestique plus lente et moins onéreuse, limiter la taille des batteries, avec une autonomie de 300 km par exemple, et réduire le recours aux métaux et autres matériaux critiques.
Des programmes qui jouent les starters
Afin de mettre leur décarbonation sur de bons rails, les acteurs du fret et de la logistique peuvent s'appuyer sur de nombreux programmes.
> Décliné en trois dispositifs – Fret21 pour les chargeurs, Evcom pour les commissionnaires et Objectif CO2 pour les transporteurs –, Eve a permis de sensibiliser plus de 7 000 entreprises. Plus de 3 000 d'entre elles se sont engagées, économisant quelque 3 mégatonnes de CO2 chaque année.
> Consacré au report modal et financé par les CEE, Remove comporte un volet sur la réduction de la consommation énergétique des flottes de transports massifiés, LOG-te, et un autre, Remo, sur la mise en œuvre concrète du report.
> L'appel à projet en R&D « Logistique 4.0 » de France 2030 est clos, mais un autre, « Programme Innovation logistique 2025 », a été lancé mercredi 2 avril avec France Logistique pour les start-up et PME innovantes.
> Démarche coopérative lancée par l'Ademe, eXtrême Défi-Logistique vise à imaginer et à déployer massivement des solutions d'optimisation pour le dernier kilomètre.
> En matière de logistique urbaine, on peut aussi citer les programmes CEE InTerLUD+, Marguerite (pour les artisans et commerçants), Cyclo-cargologie ou ColisActiv'.
L'option massification
Champion de la décarbonation, grâce à son fort potentiel de massification, le report modal vers le fer ou vers le fleuve, notamment au départ des ports, représente une autre voie à explorer, avec la perspective d'économiser 4 mégatonnes de CO2. Tout comme le transport combiné, il est donc fortement encouragé par l'État. D'ici à 2030, celui-ci espère augmenter de 50 % la part du fluvial, jusqu'à cinq fois moins émissif en CO2 que le fret routier au gazole, et doubler celle du ferroviaire, six à sept fois moins émissif, pour lui faire atteindre 18 %. Un objectif plutôt modeste, puisque la France rattraperait alors seulement la moyenne européenne.
Reste à convaincre les chargeurs, parfois un peu craintifs, d'opter pour ce mode de transport adapté aux flux réguliers, volumineux et pondéreux, mais moins souple que la route. « Cela n'est pas toujours évident. Il faut s'assurer de la disponibilité du sillon, du train et du conducteur, au moment qui nous convient, et contractualiser de nombreuses conditions à l'avance, détaille Denis Choumert, de l'AUTF. Certains flux sont compliqués. Le contournement de Paris par exemple est saturé. Il faut aussi pouvoir compter sur la performance du service et sur des solutions alternatives en cas de problème. »
Les acteurs du secteur et leurs donneurs d'ordres attendent de substantielles améliorations, des infrastructures comme de la qualité du service : disponibilité des sillons, souvent attribués en priorité aux trains de voyageurs, déploiement de la commande centralisée des 1 500 postes d'aiguillage, régénération des voies, développement et amélioration du réseau de plateformes multimodales, y compris fer-fleuve... C'est tout l'objectif d'un plan de financement de 4 milliards d'euros, Ulysse Fret, annoncé dans le cadre de la Stratégie nationale pour le fret ferroviaire (SNDFF) mais toujours en attente de garanties.
Garanties et informations
Encore mineur mais prometteur, le transport fluvial devrait se hisser, de son côté, à 3 % de part modale en 2030. Dans ce but, plusieurs projets sont en chantier, comme le canal Seine-Nord Europe à grand gabarit. Destiné à relier Paris au nord de la France, puis au Benelux, il devrait accroître les volumes transportés par voie d'eau de près de 3,3 milliards de tonnes-kilomètres en 2030. « Nous voyons déjà de gros acteurs spécialisés dans le maritime commencer à investir dans les ports fluviaux. C'est une tendance qui est amenée à s'accélérer », note Laurence Gaborieau, du SITL. Les choses se compliquent cependant en milieu urbain. « Là encore, les citoyens et les industriels entrent en compétition pour l'utilisation des berges. On ne pourra pas augmenter indéfiniment ces transports fluviaux », prévient Denis Choumert, de l'AUTF.
En parallèle, pour tous les types de report modal, les transporteurs et les commissionnaires commencent à structurer des offres clé en main assortie de garanties. De quoi faciliter la vie des industriels et les rassurer, estime Tristan Bourvon, de l'Ademe. Celui-ci encourage aussi la formation des entreprises sur ces solutions alternatives. « Il suffit que l'expert parte en retraite pour que la compétence report modal disparaisse des équipes et que l'entreprise se reporte sur le camion », observe-t-il.
Remplissage optimum
Une autre manière de massifier consiste à rationaliser les flux par la route, ainsi que les contre-flux pour réduire les retours à vide, les trajets des camions en temps réel et leur remplissage. Ces pratiques, selon la DGITM, pourrait faire reculer de 12 % le trafic de poids lourds entre 2019 et 2030. Ici ou là, chargeurs et transporteurs concurrents commencent par ailleurs à mutualiser transports et stockage. Des pratiques favorisées par le partage de la donnée. « Un meilleur remplissage passe aussi par la réduction des fréquences de livraison, souligne Tristan Bourvon. Certains magasins n'ont peut-être pas réellement besoin d'un réapprovisionnement quotidien. »
Condition nécessaire à toutes ces réorganisations : la possibilité de disposer d'un nombre suffisant d'entrepôts et autres hôtels logistiques judicieusement localisés, afin de réduire les distances à parcourir et de favoriser la flexibilité des livraisons. Mais l'équation reste difficile à résoudre face aux réticences des riverains concernés par ce type de projets et aux objectifs du zéro artificialisation nette (ZAN). En dix ans, le secteur logistique et transport a déjà contribué à hauteur de 4 % à la consommation de nouveaux espaces naturels. Un schéma de cohérence immobilier et foncier logistique sera mis à l'étude.
Enfin, l'Ademe plaide pour une meilleure prise en compte de la sobriété, susceptible de réduire les tonnes kilomètres parcourues et d'économiser 7 mégatonnes de CO2. Celle-ci passerait par la réduction des distances – relocalisation de la production, aménagement du territoire… – mais aussi de la consommation. « Il faut bien se poser la question de ce que l'on transporte, argumente Tristan Bourvon. Le transport et l'emballage des bouteilles d'eau émettent à eux seuls près de 3 mégatonnes de CO2, presque autant que la baisse attendue des émissions grâce au report modal d'ici à 2030. »
Nadia Gorbatko / actu-environnement